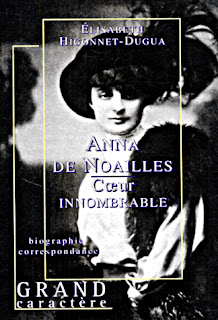Quand je rencontrai Madame de Noailles pour la première fois, je n'avais pas tout à fait vingt ans. J'avais lu, au hasard des anthologies, quelques-uns de ses poèmes. Lu assez distraitement, assez négligemment, comme pouvait le faire un jeune homme presque exclusivement voué aux choses de la science, et plus soucieux de scruter les réalités animales que de rendre justice aux imaginations humaines. Et certes, comme tout le monde, j'avais été frappé par le somptueux lyrisme du poète, par son pittoresque neuf, par le rythme ardent de son style. Mais, à vrai dire, mon admiration était restée de surface. Il me paraissait que ce lyrisme, que cette beauté, que cette splendeur ne me concernaient point, qu'ils n'étaient pas à mon usage, qu'ils excédaient les moyens de mon goût, enfin qu'ils n'avaient rien à m'apporter comme aide ni comme enseignement. Aussi, avec l'indécente promptitude de la jeunesse, avais-je rangé la comtesse de Noailles parmi ces auteurs lointains à qui l'on songe avec respect, mais sans amour.
C'est dire qu'en 1914 approcher le poète ne me semblait rien moins qu'une faveur d'exception. J'étais d'ailleurs, en ce temps, affligé d'une timidité monstrueuse, quasi morbide, qui transformait en véritable torture toute relation avec les humains : Madame de Noailles, par sa désarçonnante véhémence, par l'insolite de ses interrogations, ne pouvait que m'apparaître, de prime abord, comme un personnage singulièrement redoutable.
Et pourtant, quelques années plus tard, la vie, très paradoxale, devait faire de moi, sans que je l'eusse cherché ni voulu, l'un des familiers d'Anna de Noailles. Peu à peu désintimidé, apprivoisé, je fis partie dé ces privilégiés qui, dans sa chambre de la rue Scheffer, auprès de son lit, assistaient au spectacle étourdissant et toujours renouvelé de sa puissante et exquise vitalité. J'en suis encore à me demander par quel miracle elle tolérait, allait même jusqu'à solliciter, ma présence. J'en suis encore à me demander quel intérêt elle pouvait bien trouver à ce jeune sauvage qui, sortant de ses livres et de ses insectes, arrivé tout droit de la campagne basque, ignorait tout de la littérature, de la vie, de Paris et du monde, et n'avait à lui offrir, en retour de tant de trésors, qu'un humble silence émerveillé...
Peut-être devinait-elle, et pour en être quelque peu touchée, l'extraordinaire révélation qu'elle m'apportait. Car tout en elle me ravissait, m'enchantait, m'éblouissait. Ceux qui ne l'ont pas connue ignorent, et sans doute ils ignoreront toujours jusqu'où peut aller la force expressive du langage dans le poétique, le convaincant, le profond et le drôle. Elle disposait de tous les tons, sauf du maniéré et de l'affecté. Chez elle, l'outrance n'avait rien de théâtral, le pathétique ne sonnait jamais faux, le rare ne tournait jamais au précieux. Et quand j'évoque le prodige de son éloquence - si l'on peut appeler ainsi une vitalité à l'état pur, qui explosait en paroles - je songe moins à ces volontaires démonstrations où elle se divertissait parfois - elle appelait cela faire feu des quatre pieds - qu'à la façon spontanée dont elle parlait de son existence quotidienne à l'usage de ses intimes, dont elle racontait une lecture, un paysage ou une insomnie, l'acquisition d'un chapeau, une dispute avec un éditeur, la méprise d'un médecin, l'ennui d'un dîner officiel...
Et que dire de ces portraits qu'elle traçait en quelques phrases péremptoires, de ces caricatures lyriques où figuraient des termes de comparaison empruntés à tous les règnes de la nature, depuis le minéral jusqu'au mammifère, et dont telle était la force persuasive qu'on se trouvait à jamais empêché de voir le modèle autrement queue nous l'avait dépeint.
Célèbre est le mot d'André Breton à propos de Paul Eluard : "des yeux de pétrole fou". Mais, bien avant les surréalistes, Anna de Noailles connaissait le secret des bizarres accouplements verbaux. Elle était plus intelligente, plus malicieuse que personne. Ce poète avait la sagacité psychologique d'un Marcel Proust, l'âpreté d'un Mirbeau, la cruelle netteté d'un Jules Renard.
Sur une foule de points, elle m'instruisait, m'obligeait à réfléchir, me dessillait les yeux. Quelle hardiesse de vision, et quelle liberté de jugements Comme, d'un mot, elle savait crever les encombrantes baudruches, et, à la faveur de la poésie ou de l'humour, narguer en petite fille terrible les bienséances et les préjugés ! Elle n'avait d'illusion que bénévole, et ne s'abusait guère sur les médiocrités humaines. On eût cru parfois qu'elle n'avait vu que le côté lumineux des choses, mais non, elle avait vu aussi tout le noir. Ses enivrements n'ont jamais fait tort à ses lucidités. "Si Tristan sentait l'ail je le dirais", affirmait-elle dans une de ces formules saisissantes qui lui étaient coutumières.
Incapable de se contrefaire, elle était sans relâche invinciblement et comme organiquement - elle-même. Curieuse par générosité, elle traquait avidement la vérité dans les êtres, qu'elle forçait à livrer le peu qu'ils recelaient. A son don d'observation, rien n'échappait de ce qui, d'ordinaire, est réservé à des scrutateurs moins impétueux. D'un de ses regards d'aigle, elle avait tout embrassé, tout compris, tout jugé, jusqu'aux plus minces détails, et même ce qui n'était pas digne d'être perçu par elle.
Malgré son penchant au comique, elle redevenait éminemment sérieuse et même grave dès qu'il s'agissait des choses vraiment grandes. Il ne fallait point que, devant elle, on raillât ou diminuât les valeurs qu'elle s'était choisies. Le respect de son métier en était une. Elle ne comprenait pas, elle n'admettait pas ce parti pris de jeu et de mystification qui déjà tendait à s'introduire dans nos moeurs littéraires.
Sous son rire enfantin, toujours prêt à fuser pour un objet futile, se tenait une invariable mélancolie. Jamais elle n'était vraiment détendue, satisfaite, sans quelque arrière tristesse. Même aux époques heureuses, comblées, elle était comme auréolée de solitude et de dénuement. Elle avait au plus haut point le sens de l'amitié. L'amitié, disait-elle, est mon second métier. Et jamais, en effet, elle ne préférait son travail à la compagnie de ceux qu'elle avait élus. Toujours je l'ai vue repousser son cahier et lâcher son stylo, pour poser sa petite main en étoile sur le bras du visiteur ami.
Connaissant, d'expérience personnelle, les "chemins hérissés de la douleur physique", elle avait une grande aptitude à la pitié. Elle eût fait je ne sais quoi pour apporter un tube d'aspirine ou un flacon de gardénal à un être qui souffrait. Et cette ardente compassion, cette conscience aiguë de la misère animale du corps - jointe à un goût très sûr de la justice - donnait toute sa plénitude à son amour pour le peuple. Amour profondément sincère, et qui n'était point élégance d'aristocrate, ni même fidélité à la tradition romantique des Hugo et des Michelet... Car l'orgueil purement spirituel d'Anna de Noailles ne la privait point de fraterniser avec tous par la chair et par l'instinct. Elle vivait dans un monde haut placé, situé directement sous les étoiles, où n'atteignaient pas les cloisonnements mesquins de nos sociétés, et où la musique des sphères ne couvrait pas le sourd gémissement de la détresse humaine.
L'affectueuse admiration, le tendre enthousiasme que m'inspirait la personne d'Anna de Noailles devaient tout naturellement m'inciter à revenir à son oeuvre... Alors, l'un après l'autre, je lus ses volumes de vers, ses romans, et ses contes. Je ne fus pas long, cette fois, à découvrir l'incomparable poète, l'incomparable prosateur dont l'essentiel avait naguère échappé à ma hâte de mauvais liseur. Pour que je rendisse justice au génie, fallait-il donc que je fusse instruit par l'amitié !
Je retrouvai sur le papier tout ce qui m'avait tant séduit dans l'être réel. Car, bien sûr, tout y était (et comment cela eut-il pu ne pas y être), l'altière solitude, l'angoisse pascalienne, "la raison et le chant", la divination fraternelle des coeurs, la franchise de l'aveu, les élans de la pitié, tout, saut la prodigieuse drôlerie, qu'Anna de Noailles n'a jamais voulu accepter dans son oeuvre écrite.
Toutes ces vertus de l'âme et de l'art, il me semble qu'elles n'ont pas cessé d'éclater toujours davantage dans l'oeuvre d'Anna de Noailles, et singulièrement dans le Poème de l'Amour, où elle laisse délibérément tomber le voile des splendeurs, et dans ce bouleversant Honneur de souffrir où l'excès de la douleur a coupé le souffle du poète. Jamais peut-être, dans aucun livre de prose ou de vers, ne s'étaient exprimées avec autant d'austère passion la stupeur de l'esprit devant l'escamotage de la mort, et l'incompréhension du départ suprême, et la honte de survivre, et la décision de continuer à traiter en avant celui qui n'est plus là. Car il ne s'agit pas, dans l'Honneur de souffrir, de regrets et de souvenirs ; l'exceptionnelle force de cette élégie funèbre est d'être vécue au présent, non au passé. Jamais on n'avait mis tant de feu pour s'adresser à des cendres, jamais on n'avait à ce point tenu compagnie à des morts, trahi la lumière pour la ténèbres déserté la vie au profit des tombeaux.
Et, de ce livre, il monte un terrible cri de révolte, le plus violent qu'on ait poussé depuis Leopardi. Révolte contre la terrestre planète qui résorbe nonchalamment les humains, contre le spécieux univers, contre la vie mensongère qui porte en soi-même son échec, contre la pensée, réduite à porter envie au doux néant préliminaire : "Lieu d'avant la naissance, unique réussite"
On ne survit pas très longuement à un livre pareil. Anna de Noailles, en 1927, avait vu disparaître, coup sur coup, les êtres qui étaient les principaux motifs de son existence. Un jour, c'en fut trop... Elle chancela. Nous ne tardâmes pas à comprendre qu'elle était, cette fois, trop rudement frappée et que tous les efforts de ses vivants auraient peine à la disputer à la silencieuse conspiration de ses morts... Anna de Noailles ne vivrait plus désormais qu'assistée par l'espoir de suivre ceux qui l'avaient abandonnée. Non pas, certes, qu'elle nourrit l'illusion de les rejoindre, car elle était dépourvue de ces croyances consolatrices, et l'excès même de son mal ne faisait que la roidir dans une impavide négation. Mais elle voyait dans la mort - la bonne mort, comme disait Lucrèce - le suprême calmant, le seul somnifère capable de la délivrer de tant d'absences : "Je ne peux plus m'entendre disait-elle, qu'avec ceux qui sont en amitié avec la mort".
[ ... ] Nous-mêmes, avouons-le, nous ses amis, l'eussions-nous deviné, qu'elle était capable d'une si rigoureuse aliénation ? Le savions-nous, que cette vivante unique pouvait connaître à ce point le manque d'autrui ? Même en lisant les terribles vers de l'Honneur de souffrir, nous pensions, nous espérions que la plainte s'était laissé amplifier par le génie... Nous hésitions à prendre tout à fait à la lettre ces serments faits à des tombeaux... Mais, hélas, nous dûmes reconnaître que le cri, pour une fois, n'avait pas dépassé le mal. Et ce fut, à mes yeux du moins, la période la plus haute, la plus touchante de l'existence d'Anna de Noailles que celle où nous comprimes, par son inguérissable tristesse, que son coeur - bien plus grand de n'être pas innombrable - s'était farouchement refermé sur quelques-uns.
Heure probante, où s'authentifiait toute son oeuvre, et où nous pûmes donner tout son sens à cette phrase qui jadis nous faisait sourire : "Pour moi j'ai été une muette". Rien ne pouvait plus la distraire, ni la nature, ni le travail, ni elle-même. Nous la vîmes peu à peu s'enfoncer dans la nuit. Un instant, nous pûmes croire que des fleurs de pastel allaient la retenir. Mais ce ne fut qu'une halte. De toute chose, elle se dépouillait peu à peu, et même de cette ambition créatrice qui la dévorait autrefois.
"Quel beau livre j'écrirais si je revenais de ces sombres régions et si je croyais encore assez à la vie pour avoir envie d'écrire". Et, comme nous la pressions d'ajouter à son oeuvre "Est-ce que tout finira, mon petit ? Alors ? N'ai-je pas fait assez de cadeaux au néant ?"
Aussi, quand vint l'heure où la nature - par des voies qui sont restées quelque peu obscures à la médecine - se fit la complice de ses voeux, nous assistâmes au spectacle de sa calme résignation. Cette grande rebelle s'abandonnait, se soumettait aux lois de la réalité; cette nietzschéenne s'éteignait selon Marc-Aurèle. Tant de sagesse finale devait donner à notre douleur une forme que nous n'eussions pas prévue. Car, malgré notre déchirement, nous ne pouvions que nous incliner avec respect devant l'exemplaire exactitude de celle qui avait écrit
"Certes il est altier d'opposer le courage
A ce que l'on voit défleurir
Et d'aborder en paix les défaites de l'âge,
Mais il est plus pur de mourir".
--------------------------
Voir également les messages 49 et 50 : en raison de la longuer de ce blog, certains textes jugés plus particulièrement intéressants sont reproduits deux fois.
--------------------------
01/02/2012
360. Francois Mauriac : Anna de Noailles est morte
Cette jeune femme illustre prêta sa voix à toute une jeunesse tourmentée. Sa poésie fut le cri de notre adolescence. Auprès des autres, nous cherchions l'apaisement, la lumière; ou nous leur demandions d'être bercés et endormis. Mais elle attirait à soi les passions qui ne veulent pas guérir. Quelle tentation, pour un jeune cœur, que de découvrir Dieu au-delà de l'assouvissement !
Admirée, adorée, chargée et comme accablée de tous les dons humains, elle nous précédait de dix années dans la vie, pour que nous fussions avertis que posséder tout, c'est ne rien avoir, et qu'il ne sert à rien de gagner l'univers. L'univers, elle l'avait pondant capté dans ses poèmes où Venise, Sorrente, la Sicile nous semblaient plus chaudes et plus odorantes que dans le réel. Mais de tous les jardins du monde, elle rapportait les seules herbes nécessaires pour composer le philtre qu'Iseult partage avec Tristan et elle nous le faisait boire. Elle n'a jamais distingué l'amour de la mort. Son exigence débordait infiniment l'amour humain. Dans les poèmes admirables qui ouvrent le recueil les Vivants et les Morts, elle sut nous rendre sensible la fuite de la créature aimée, même tenue et pressée entre nos bras :
Quelque chose de toi sans cesse m'abandonne,
Car rien qu'en vivant, tu t'en vas...
Cette trahison, en pleine fidélité, de l'être qui s'écoule, qui se défait; ce mensonge de la vie, elle fut la première à nous en persuader. Notre vingtième année lui doit d'avoir connu cette disproportion entre le désir du cœur et ce qu'il poursuit jusqu'à épuisement. Il ne servait de rien à notre jeune passion d'atteindre son objet, puisqu’elle n’en épousait jamais les contours. La beauté, enfin appréhendée, ne ressemblait pas à celle qui nous avait fui :
Je me tairai, je veux, les yeux larges ouverts,
Regarder quel éclat a votre vrai visage,
Et si vous ressembler à ce que j'ai souffert.
Ce défaut de conformité entre l'amour et l'objet de l'amour éveillait en nous une douleur qui, devenait l'amour même, ou du moins, tout ce qu'en dehors de la volupté il nous était donné d'en connaître. Par l'unique douleur, l'amour humain prenait conscience de lui-même, au point que, si nous ne faisions pas souffrir, nous ne savions pas que nous étions aimés. Les amants ne se connaissent qu'au mal qu'ils se font qu'aux coups qu'ils se portent. Toute la misère de l'attachement aux créatures tient dans ce vers impérissable :
La paix qui m'envahit quand c'est vous qui souffrez.
Et cependant, rien n'arrête, puisqu'ils sont vivante, l'incessante dissolution de ces deux corps qui se cherchent. En vain le poète s'efforce-t-il de fixer l'instant et le lien de sa joie :
La terrasse est comme un navire
Qu'il fait chaud sur la mer ce soir !
Rien n'est immobile; tout parapet devient une proue ; la nature entière bouge comme le vaisseau de Tristan et entraîne à la mort le couple éphémère.
[...] Dès sa jeunesse, ce bel aigle avait regardé la mort en face. Pareille aux grands romantiques, elle n'en a jamais détourné les yeux. Et c'est ce qui rend sa mort si étonnante. Pour la plupart des hommes, mourir est un accident : ils trébuchent et disparaissent dans la trappe comme des bêtes surprises. Mais de celle-là qui, depuis tant d'années, contemplait et, si j'ose dire, veillait sa future dépouille, le silence, l'immobilité déroutent l'esprit. Je répète à cette endormie le mot du Christ après la Cène, lorsqu'il interroge ses disciples : « Vous croyez, maintenant ? » Elle sait, maintenant. Elle sait... Elle voit.
Durant toute une vie, aura-t-elle contemplé la mort en vain ? A cet esprit, l'un des plus avides que nous ayons connus, la mort ne révéla rien de ce que dissimulent ses ténèbres. Penchée depuis l'enfance sur ce gouffre d'éternelle clarté, Madame de Noailles a toujours donné son cœur et son consentement à la nuit.
Pourquoi, en dehors d'un imprévisible miracle, sentions-nous qu'il en devait être ainsi ? Elle-même paraissait terriblement sûre de ne jamais succomber à la tentation de Dieu, comme si elle eût été tirée sur la berge, très loin du courant de grâce où beaucoup de ses jeunes frères se sentaient entraînés. Elle paraphrasait en vain Pascal dans de sublimes Élévations. Elle dressait en vain vers Dieu l'holocauste de ses poèmes :
Mon Dieu, je ne sais rien, mais je sais que je souffre !
La fumée du sacrifice était rabattue vers la terre. C'est qu'il ne sert à rien d'interpeller Dieu si nous ne l'écoutons pas. L'attention dans le silence est un aspect trop méconnu de la prière. Ce cœur innombrable, ce cœur retentissant ne se taisait jamais. Cet essaim bourdonnant, que pouvait-il entendre, hors son bourdonnement admirable ? «Il faut d'abord avoir soif » ; ce mot de Catherine de Sienne que Madame de Noailles inscrivit en exergue du Poème de l'amour - quelle triste habitude nous eûmes tous de dérober aux saints leurs plus pures paroles, pour faire le jeu de notre passion - ce mot l'aurait sans doute éclairée, si elle l'eût ainsi compris : « Soif de ce silence où Dieu nous parle. » Peut-être alors eût-elle entendu la parole intérieure qui fut adressée à Catherine de Sienne : « Tu es celle qui n'est pas... » C'était le mot de l'énigme,, et Madame de Noailles ne l'a pas trouvé. Elle est demeurée inguérissablement elle-même, aveuglée par sa propre lumière. A l'entour, les planètes humaines ne lui apparaissaient que dans l'éblouissement de ses rayons.
La jeunesse s'éloignait ; les nouvelles générations portaient leur encens à d'autres idoles ; autour de cette femme étendue, une terrible cognée abattait ceux qu’elle chérissait le plus. La solitude et le silence prirent ainsi possession, par la force, de cette vie tumultueuse jusqu'à ce qu’elle fût définitivement immobilisée, crucifiée à la maladie. N'allons pas au delà ; agenouillons-nous devant ce mystère des derniers jours où, vaincue enfin, dépouillée de toutes ses armes, cette grande inspirée reçut peut-être les seules inspirations qui lui fussent inconnues, celles qui ne s'obtiennent, nous enseigne Pascal, que par les humiliations. […] C’est une dangereuse épreuve que l'excès de bonheur. Les anciens n'avaient pas tort de redouter une chance trop constante ; la créature comblée finit toujours par être accablée.
Il est des êtres sur qui le bonheur humain s'acharne, comme s'il était le malheur, et, en vérité, il est le malheur. Ce grand poète qui vient de s'endormir, nous l'avons vu dans l'éclat de sa jeune gloire. D'autres femmes étaient belles, mais elle seule possédait cette beauté que le génie transfigure. Princesse dès le berceau, elle reçut, au jour de ses noces, un des plus grands noms de France, et des plus glorieux; mais à peine l'eut-elle porté, que l'éclat de son génie obscurcit les fastes de cette famille illustre; et désormais le nom de Noailles n'évoquera plus le vainqueur de Cérisoles, ni cet archevêque de Paris, ami secret des jansénistes et pour qui Racine écrivit l'histoire de Port-Poyal, ni trois maréchaux de France, mais une jeune Minerve revenue de toute sagesse, docile au seul vertige, et qui, comme l’Euphorion de Goethe, s'élance à corps perdu « dans un espace plein de douleurs »
[...] Qu'elle était heureuse, cette désespérée ! Son génie jouissait de lui-même, à chaque instant de sa vie ; et non pas seulement lorsque, poète, elle cédait, dans le secret, à ses sublimes inspirations; car elle régnait aussi par la parole. Dans ces beaux jours de notre jeunesse, dès qu’elle apparaissait, nous nous pressions autour d'elle toujours accablée, mais dont l'épuisement même entretenait l'ivresse. Elle faisait rire aux larmes des adolescents que ses poèmes enivraient de tristesse, le soir, dans leur chambre solitaire. Furieuse et joyeuse abeille, elle fonçait soudain sur ses victimes, car elle voyait le ridicule des gens, selon le mot de Saint-Simon, « avec cette vérité qui assomme ». Insoucieuse du dard qu’elle laissait dans la plaie, la téméraire ne se méfiait pas de cette terrible mémoire qui est celle de l'amour-propre humilié, pareille à cette dauphine Marie-Antoinette, à cette jeune reine adorée, mais qui charmait moins de cœurs queue n'en blessait. Tant qu'une seule chose nous manque, nous espérons l'atteindre et le désespoir reste impossible. Mais rien ne manquait à cette reine de notre jeunesse; et elle obtint donc, par surcroît, le désespoir si nécessaire aux poètes. Il faut tout avoir, pour ne tenir compte de rien, tout posséder, pour avoir le droit de tout mépriser. Il n'y a pas de détachement possible sans possession, car comment nous détacher de ce que nous n'avons pas ?
Aucun humble désir, aucun « manque » ne détournait de penser à la mort cette créature idolâtrée, envers qui le destin se montrait perfidement prodigue. Nul médiocre souci ne la divertissait de son unique disgrâce, la seule dont aucune puissance, sur la terre ni dans le ciel, ne la pouvait délivrer : cette disgrâce d'être née mortelle et de ne donner son cœur qu'à des créatures aussi éphémères qu'elle-même. L'écoulement, la fuite, la dissolution de l'être adoré devint ainsi le motif essentiel de cette poésie, si longtemps consacrée à tous les ciels et à tous les jardins du monde. Le thème bergsonien de la durée - qui devait trouver, grâce à Proust, sa transposition romanesque - fournit à cette porteuse de lyre une source de sublime...
[…] Jusqu'à ce jour où il devint visible que le temps altérait aussi le seul de ses biens quelle aurait cru inaltérable : sa gloire. Dans le tumulte de son long triomphe, rien ne l'avait pu préparer à cette épreuve inévitable et qui n'épargne aucun créateur ni, surtout en France, aucun poète, car c'est la politique, et non la poésie, qui fit du vieil Hugo l'idole de la France !
« Ce grand supplice, la vieillesse ! » notait Michelet à son déclin. il aurait pu dire : ce supplice sans cesse grandissant, l'approche même encore éloignée de la vieillesse ; oui, le pire des supplices pour ceux, du moins, dont la route glorieuse ne monte pas vers Dieu; supplice qui, pour être supporté sans cri, exige un courage d'homme, une raison d'homme. Dans ces ténèbres où il aurait fallu qu’elle fît un acte de foi dans son génie, la triomphatrice de naguère ne nous apparaissait plus que comme une pauvre femme, stupéfaite, anxieuse.
C'est que, dans l'orgueil des poètes, il ne faut voir qu'une apparence. Il n'en est aucun, même parmi les plus grands, qui ne doute de soi, que la moindre critique ne trouble, qui n'ait besoin, comme de pain et d'eau, d'admiration et de louanges. Mais nous, qui étions sûrs que l’œuvre de Madame de Noailles vaincrait le temps, nous nous irritions de la sentir si démunie. Hé quoi ! il ne lui suffisait pas de relire les Vivants et les Morts pour consentir à l'indifférence des jeunes barbares d'après la guerre ?
[...] C'était l'époque où, après un long temps d-incubation, le virus de Rimbaud se manifestait dans la poésie française; l'époque où un jeune insolent disait devant moi à Madame de Noailles : « On ne fait plus de vers, aujourd'hui, madame !», l'époque enfin où, dans la lignée de Mallarmé, se manifestait un poète attentif à la valeur et au poids de chaque mot, ennemi de toute facilité. Dans les premiers jours après l'Armistice, je me vois encore, chez le libraire Floury, lisant d'un trait la Jeune Parque de ce Paul Valéry […] aux antipodes du « Cœur Innombrable » et des « Eblouissements .
Mais il y a, chez les Muses, beaucoup de demeures ; et dans ce temps où je me sentais proche encore de mes belles années, bourdonnantes de tous les poètes, les dieux nouveaux n’empiétaient pas sur mes anciennes adorations. Aucun de nous qui ne soit demeuré fidèle à celle dont la poésie fut la voix même de notre jeune passion. Peut-être aurions-nous dû le lui redire; mais nous ne pensions pas que cette. immortelle eût besoin d'être rassurée. Cette apparente désaffection, ce silence que le monde fait autour d'une destinée qui décline, heureux sont ceux qui ne le redoutent pas et qui même l'attendent avec une anxieuse espérance. Il est bon qu'avant que nous le quittions, le monde nous quitte. Autour du vaisseau qu'on va lancer à la mer, toutes les amarres, l'une après l'autre, sont rompues ; il demeure immobile, il ne glisse pas encore, quoique plus rien ne le retienne. Bénie soit la vieillesse qui nous détache longtemps à l'avance, afin que le passage à l'éternité s'accomplisse sans déchirement. En haine de la vieillesse, le monde renonce à nous qui n'aurions peut- être pas la force de renoncer à lui. Puissions-nous en ces jours-là, lui rendre grâce d'obliger la frivole créature à demeurer seule en face de son créateur. « Quand on vieillit, notait René Bazin à la veille de mourir, quand on vieillit, tout s'en va, mais Dieu vient ! »
Il vient, mais son approche est différente pour chacun. Peut-être - je l'ai toujours cru - ne traite-t-il pas les poètes comme les autres hommes. Tout se passe comme si les poètes avaient une mission particulière, un exemple à donner et que seuls ils peuvent donner ; comme si leur vie, telle quelle est, était voulue. Tous, qu'ils aient cru à la vie éternelle ou qu'à l'exemple d'Anna de Noailles ils l'aient niée, ils attestent la grandeur de l'âme humaine, sa vocation divine. Les poètes m'ont toujours défendu contre le doute : même couverts de boue, comme Rimbaud et Verlaine, ils, éveillent,-en nous le sentiment d'une pureté édénique, d'une pureté perdue qu'il nous faut retrouver dans l'abaissement et dans les larmes. Battus de tous les vents, ruisselants de tous les embruns, ils sont bien des « phares », ainsi que Baudelaire les appelle, immobiles sur leur rocher, incapables en apparence de se sauver eux-mêmes, ils brûlent dans les ténèbres, mais notre route est inondée de leur lumière. Aussi éloignés qu'ils paraissent les uns des autres, ces inspirés bien-aimés gardent entre eux un air de parenté, une ressemblance mystérieuse. Les trimardeurs terribles, Verlaine, Rimbaud et la comtesse de Noailles, née princesse de Brancovan, ont une vocation commune d'ardeur, de souffrance et de grandeur humiliée. La chambre sordide où Verlaine mourut, nu, la face contre le carreau, je la confonds dans mon esprit avec la pauvre chambre -meublée, rue Hamelin, où j'ai vu Marcel Proust étendu; avec la chambre de la rue Scheffer, où un « cœur innombrable » a fini de souffrir.
----------------
Voir également les messages 63, 64, 65, 66 : en raison de la longueur de ce blog, certains textes jugés plus particulièrement intéressants sont reproduits deux fois.
---------------
Admirée, adorée, chargée et comme accablée de tous les dons humains, elle nous précédait de dix années dans la vie, pour que nous fussions avertis que posséder tout, c'est ne rien avoir, et qu'il ne sert à rien de gagner l'univers. L'univers, elle l'avait pondant capté dans ses poèmes où Venise, Sorrente, la Sicile nous semblaient plus chaudes et plus odorantes que dans le réel. Mais de tous les jardins du monde, elle rapportait les seules herbes nécessaires pour composer le philtre qu'Iseult partage avec Tristan et elle nous le faisait boire. Elle n'a jamais distingué l'amour de la mort. Son exigence débordait infiniment l'amour humain. Dans les poèmes admirables qui ouvrent le recueil les Vivants et les Morts, elle sut nous rendre sensible la fuite de la créature aimée, même tenue et pressée entre nos bras :
Quelque chose de toi sans cesse m'abandonne,
Car rien qu'en vivant, tu t'en vas...
Cette trahison, en pleine fidélité, de l'être qui s'écoule, qui se défait; ce mensonge de la vie, elle fut la première à nous en persuader. Notre vingtième année lui doit d'avoir connu cette disproportion entre le désir du cœur et ce qu'il poursuit jusqu'à épuisement. Il ne servait de rien à notre jeune passion d'atteindre son objet, puisqu’elle n’en épousait jamais les contours. La beauté, enfin appréhendée, ne ressemblait pas à celle qui nous avait fui :
Je me tairai, je veux, les yeux larges ouverts,
Regarder quel éclat a votre vrai visage,
Et si vous ressembler à ce que j'ai souffert.
Ce défaut de conformité entre l'amour et l'objet de l'amour éveillait en nous une douleur qui, devenait l'amour même, ou du moins, tout ce qu'en dehors de la volupté il nous était donné d'en connaître. Par l'unique douleur, l'amour humain prenait conscience de lui-même, au point que, si nous ne faisions pas souffrir, nous ne savions pas que nous étions aimés. Les amants ne se connaissent qu'au mal qu'ils se font qu'aux coups qu'ils se portent. Toute la misère de l'attachement aux créatures tient dans ce vers impérissable :
La paix qui m'envahit quand c'est vous qui souffrez.
Et cependant, rien n'arrête, puisqu'ils sont vivante, l'incessante dissolution de ces deux corps qui se cherchent. En vain le poète s'efforce-t-il de fixer l'instant et le lien de sa joie :
La terrasse est comme un navire
Qu'il fait chaud sur la mer ce soir !
Rien n'est immobile; tout parapet devient une proue ; la nature entière bouge comme le vaisseau de Tristan et entraîne à la mort le couple éphémère.
[...] Dès sa jeunesse, ce bel aigle avait regardé la mort en face. Pareille aux grands romantiques, elle n'en a jamais détourné les yeux. Et c'est ce qui rend sa mort si étonnante. Pour la plupart des hommes, mourir est un accident : ils trébuchent et disparaissent dans la trappe comme des bêtes surprises. Mais de celle-là qui, depuis tant d'années, contemplait et, si j'ose dire, veillait sa future dépouille, le silence, l'immobilité déroutent l'esprit. Je répète à cette endormie le mot du Christ après la Cène, lorsqu'il interroge ses disciples : « Vous croyez, maintenant ? » Elle sait, maintenant. Elle sait... Elle voit.
Durant toute une vie, aura-t-elle contemplé la mort en vain ? A cet esprit, l'un des plus avides que nous ayons connus, la mort ne révéla rien de ce que dissimulent ses ténèbres. Penchée depuis l'enfance sur ce gouffre d'éternelle clarté, Madame de Noailles a toujours donné son cœur et son consentement à la nuit.
Pourquoi, en dehors d'un imprévisible miracle, sentions-nous qu'il en devait être ainsi ? Elle-même paraissait terriblement sûre de ne jamais succomber à la tentation de Dieu, comme si elle eût été tirée sur la berge, très loin du courant de grâce où beaucoup de ses jeunes frères se sentaient entraînés. Elle paraphrasait en vain Pascal dans de sublimes Élévations. Elle dressait en vain vers Dieu l'holocauste de ses poèmes :
Mon Dieu, je ne sais rien, mais je sais que je souffre !
La fumée du sacrifice était rabattue vers la terre. C'est qu'il ne sert à rien d'interpeller Dieu si nous ne l'écoutons pas. L'attention dans le silence est un aspect trop méconnu de la prière. Ce cœur innombrable, ce cœur retentissant ne se taisait jamais. Cet essaim bourdonnant, que pouvait-il entendre, hors son bourdonnement admirable ? «Il faut d'abord avoir soif » ; ce mot de Catherine de Sienne que Madame de Noailles inscrivit en exergue du Poème de l'amour - quelle triste habitude nous eûmes tous de dérober aux saints leurs plus pures paroles, pour faire le jeu de notre passion - ce mot l'aurait sans doute éclairée, si elle l'eût ainsi compris : « Soif de ce silence où Dieu nous parle. » Peut-être alors eût-elle entendu la parole intérieure qui fut adressée à Catherine de Sienne : « Tu es celle qui n'est pas... » C'était le mot de l'énigme,, et Madame de Noailles ne l'a pas trouvé. Elle est demeurée inguérissablement elle-même, aveuglée par sa propre lumière. A l'entour, les planètes humaines ne lui apparaissaient que dans l'éblouissement de ses rayons.
La jeunesse s'éloignait ; les nouvelles générations portaient leur encens à d'autres idoles ; autour de cette femme étendue, une terrible cognée abattait ceux qu’elle chérissait le plus. La solitude et le silence prirent ainsi possession, par la force, de cette vie tumultueuse jusqu'à ce qu’elle fût définitivement immobilisée, crucifiée à la maladie. N'allons pas au delà ; agenouillons-nous devant ce mystère des derniers jours où, vaincue enfin, dépouillée de toutes ses armes, cette grande inspirée reçut peut-être les seules inspirations qui lui fussent inconnues, celles qui ne s'obtiennent, nous enseigne Pascal, que par les humiliations. […] C’est une dangereuse épreuve que l'excès de bonheur. Les anciens n'avaient pas tort de redouter une chance trop constante ; la créature comblée finit toujours par être accablée.
Il est des êtres sur qui le bonheur humain s'acharne, comme s'il était le malheur, et, en vérité, il est le malheur. Ce grand poète qui vient de s'endormir, nous l'avons vu dans l'éclat de sa jeune gloire. D'autres femmes étaient belles, mais elle seule possédait cette beauté que le génie transfigure. Princesse dès le berceau, elle reçut, au jour de ses noces, un des plus grands noms de France, et des plus glorieux; mais à peine l'eut-elle porté, que l'éclat de son génie obscurcit les fastes de cette famille illustre; et désormais le nom de Noailles n'évoquera plus le vainqueur de Cérisoles, ni cet archevêque de Paris, ami secret des jansénistes et pour qui Racine écrivit l'histoire de Port-Poyal, ni trois maréchaux de France, mais une jeune Minerve revenue de toute sagesse, docile au seul vertige, et qui, comme l’Euphorion de Goethe, s'élance à corps perdu « dans un espace plein de douleurs »
[...] Qu'elle était heureuse, cette désespérée ! Son génie jouissait de lui-même, à chaque instant de sa vie ; et non pas seulement lorsque, poète, elle cédait, dans le secret, à ses sublimes inspirations; car elle régnait aussi par la parole. Dans ces beaux jours de notre jeunesse, dès qu’elle apparaissait, nous nous pressions autour d'elle toujours accablée, mais dont l'épuisement même entretenait l'ivresse. Elle faisait rire aux larmes des adolescents que ses poèmes enivraient de tristesse, le soir, dans leur chambre solitaire. Furieuse et joyeuse abeille, elle fonçait soudain sur ses victimes, car elle voyait le ridicule des gens, selon le mot de Saint-Simon, « avec cette vérité qui assomme ». Insoucieuse du dard qu’elle laissait dans la plaie, la téméraire ne se méfiait pas de cette terrible mémoire qui est celle de l'amour-propre humilié, pareille à cette dauphine Marie-Antoinette, à cette jeune reine adorée, mais qui charmait moins de cœurs queue n'en blessait. Tant qu'une seule chose nous manque, nous espérons l'atteindre et le désespoir reste impossible. Mais rien ne manquait à cette reine de notre jeunesse; et elle obtint donc, par surcroît, le désespoir si nécessaire aux poètes. Il faut tout avoir, pour ne tenir compte de rien, tout posséder, pour avoir le droit de tout mépriser. Il n'y a pas de détachement possible sans possession, car comment nous détacher de ce que nous n'avons pas ?
Aucun humble désir, aucun « manque » ne détournait de penser à la mort cette créature idolâtrée, envers qui le destin se montrait perfidement prodigue. Nul médiocre souci ne la divertissait de son unique disgrâce, la seule dont aucune puissance, sur la terre ni dans le ciel, ne la pouvait délivrer : cette disgrâce d'être née mortelle et de ne donner son cœur qu'à des créatures aussi éphémères qu'elle-même. L'écoulement, la fuite, la dissolution de l'être adoré devint ainsi le motif essentiel de cette poésie, si longtemps consacrée à tous les ciels et à tous les jardins du monde. Le thème bergsonien de la durée - qui devait trouver, grâce à Proust, sa transposition romanesque - fournit à cette porteuse de lyre une source de sublime...
[…] Jusqu'à ce jour où il devint visible que le temps altérait aussi le seul de ses biens quelle aurait cru inaltérable : sa gloire. Dans le tumulte de son long triomphe, rien ne l'avait pu préparer à cette épreuve inévitable et qui n'épargne aucun créateur ni, surtout en France, aucun poète, car c'est la politique, et non la poésie, qui fit du vieil Hugo l'idole de la France !
« Ce grand supplice, la vieillesse ! » notait Michelet à son déclin. il aurait pu dire : ce supplice sans cesse grandissant, l'approche même encore éloignée de la vieillesse ; oui, le pire des supplices pour ceux, du moins, dont la route glorieuse ne monte pas vers Dieu; supplice qui, pour être supporté sans cri, exige un courage d'homme, une raison d'homme. Dans ces ténèbres où il aurait fallu qu’elle fît un acte de foi dans son génie, la triomphatrice de naguère ne nous apparaissait plus que comme une pauvre femme, stupéfaite, anxieuse.
C'est que, dans l'orgueil des poètes, il ne faut voir qu'une apparence. Il n'en est aucun, même parmi les plus grands, qui ne doute de soi, que la moindre critique ne trouble, qui n'ait besoin, comme de pain et d'eau, d'admiration et de louanges. Mais nous, qui étions sûrs que l’œuvre de Madame de Noailles vaincrait le temps, nous nous irritions de la sentir si démunie. Hé quoi ! il ne lui suffisait pas de relire les Vivants et les Morts pour consentir à l'indifférence des jeunes barbares d'après la guerre ?
[...] C'était l'époque où, après un long temps d-incubation, le virus de Rimbaud se manifestait dans la poésie française; l'époque où un jeune insolent disait devant moi à Madame de Noailles : « On ne fait plus de vers, aujourd'hui, madame !», l'époque enfin où, dans la lignée de Mallarmé, se manifestait un poète attentif à la valeur et au poids de chaque mot, ennemi de toute facilité. Dans les premiers jours après l'Armistice, je me vois encore, chez le libraire Floury, lisant d'un trait la Jeune Parque de ce Paul Valéry […] aux antipodes du « Cœur Innombrable » et des « Eblouissements .
Mais il y a, chez les Muses, beaucoup de demeures ; et dans ce temps où je me sentais proche encore de mes belles années, bourdonnantes de tous les poètes, les dieux nouveaux n’empiétaient pas sur mes anciennes adorations. Aucun de nous qui ne soit demeuré fidèle à celle dont la poésie fut la voix même de notre jeune passion. Peut-être aurions-nous dû le lui redire; mais nous ne pensions pas que cette. immortelle eût besoin d'être rassurée. Cette apparente désaffection, ce silence que le monde fait autour d'une destinée qui décline, heureux sont ceux qui ne le redoutent pas et qui même l'attendent avec une anxieuse espérance. Il est bon qu'avant que nous le quittions, le monde nous quitte. Autour du vaisseau qu'on va lancer à la mer, toutes les amarres, l'une après l'autre, sont rompues ; il demeure immobile, il ne glisse pas encore, quoique plus rien ne le retienne. Bénie soit la vieillesse qui nous détache longtemps à l'avance, afin que le passage à l'éternité s'accomplisse sans déchirement. En haine de la vieillesse, le monde renonce à nous qui n'aurions peut- être pas la force de renoncer à lui. Puissions-nous en ces jours-là, lui rendre grâce d'obliger la frivole créature à demeurer seule en face de son créateur. « Quand on vieillit, notait René Bazin à la veille de mourir, quand on vieillit, tout s'en va, mais Dieu vient ! »
Il vient, mais son approche est différente pour chacun. Peut-être - je l'ai toujours cru - ne traite-t-il pas les poètes comme les autres hommes. Tout se passe comme si les poètes avaient une mission particulière, un exemple à donner et que seuls ils peuvent donner ; comme si leur vie, telle quelle est, était voulue. Tous, qu'ils aient cru à la vie éternelle ou qu'à l'exemple d'Anna de Noailles ils l'aient niée, ils attestent la grandeur de l'âme humaine, sa vocation divine. Les poètes m'ont toujours défendu contre le doute : même couverts de boue, comme Rimbaud et Verlaine, ils, éveillent,-en nous le sentiment d'une pureté édénique, d'une pureté perdue qu'il nous faut retrouver dans l'abaissement et dans les larmes. Battus de tous les vents, ruisselants de tous les embruns, ils sont bien des « phares », ainsi que Baudelaire les appelle, immobiles sur leur rocher, incapables en apparence de se sauver eux-mêmes, ils brûlent dans les ténèbres, mais notre route est inondée de leur lumière. Aussi éloignés qu'ils paraissent les uns des autres, ces inspirés bien-aimés gardent entre eux un air de parenté, une ressemblance mystérieuse. Les trimardeurs terribles, Verlaine, Rimbaud et la comtesse de Noailles, née princesse de Brancovan, ont une vocation commune d'ardeur, de souffrance et de grandeur humiliée. La chambre sordide où Verlaine mourut, nu, la face contre le carreau, je la confonds dans mon esprit avec la pauvre chambre -meublée, rue Hamelin, où j'ai vu Marcel Proust étendu; avec la chambre de la rue Scheffer, où un « cœur innombrable » a fini de souffrir.
----------------
Voir également les messages 63, 64, 65, 66 : en raison de la longueur de ce blog, certains textes jugés plus particulièrement intéressants sont reproduits deux fois.
---------------
359. Charles Maurras : la comtesse de Noailles
Grecque et roumaine d'origine, née à Paris, élevée en France, devenue Française par son mariage, Madame de Noailles a dédié le premier recueil de ses vers « aux paysages d'Ile-de-France, ardents et limpides, pour qu'ils les protègent de leurs ombrages ». Elle s'est écriée, dès la première pièce, « ma France ! » et cette prise de possession forme un petit hymne au pays Les chansons de Ronsard, le cœur de Jean Racine, sont invoqués d'un accent qui ne manque pas de piété. Mais le même livre a pour titre « le Cœur innombrable », et cette alliance violente d'un adjectif avec un nom qui n'est pas fait pour lui sentait son étrange pays et ne laissait pas d'inquiéter.
L'inquiétude se confirme par la suite du livre; on ne tarde pas à s'apercevoir que, si Racine et Ronsard sont aimés ici, ils n'y sont aucunement préférés. Le suffrage qu'on leur accorde est très partagé. Une petite âme gloutonne s'est contentée de les convier à la posséder, en commun avec une nombreuse société de poètes inférieurs. Les véritables favoris sont bien plus récents et moins purs.
Pour la quatrième fois, nous avons à saluer l'influence persistante et vivace des romantiques sur le plus brillant esprit féminin. C'est bien d'eux que Madame de Noailles a mémoire quand elle songe, écrit et vit. La face épanouie de la lune l'émeut à peu près des mêmes pensées qui auraient visité l'imagination d'une affiliée du Cénacle. C'est la rêverie de Musset devant Pboebé la blonde. A propos d'animaux, des « sobres animaux », quand elle les admire et les salue un à un, en suppliant une divinité champêtre de la rendre elle-même pareille à ces bestiaux suaves : Rendez-nous l'innocence ancestrale des bêtes ! le souvenir de Baudelaire s'entrelace à celui de Vigny, qui voulait que les animaux fussent nos sublimes modèles. Enfin, elle s'est exercée à fusionner, sur les savants exemples de Victor Hugo, le matériel et le mystique, le pittoresque et le rêvé, le sentiment et la chair :
Ah ! le mal que ces deux cœurs, certes,
Se feront ;
Le vent éperdu déconcerte
L’astre rond.
La lune au ciel et sur l'eau tremble,
Rêve et luit ;
Nos deux détresses de ressemblent,
Cette nuit.
Il monte des portes de l’âme
Un encens;
C'est l'appel du cœur, de la flamme
Et du sang.
Nous avons distingué des imitations que l'on fait comme des devoirs ces reprises sincères et fiévreuses, que l'auteur dirait pleines de cœur et pleines de sang. A la fougue, à la vérité, au naturel se reconnaît l'invention. C'est seulement une invention qu'il faut dater et situer. Laissons donc Ronsard et Racine. Voici le centre du poète, voici la date fatidique de son avènement au ciel troublé de la poésie . Dix-huit-cent-trente. S'il était possible d'en douter, nous n'aurions qu'à ouvrir ce roman, la Nouvelle Espérance, qui nous ressuscite à la lettre les sentiments de la génération de René et de celle d'Adolphe, avec cette couleur précise du costume et de la parure que la vogue de 1830 y vint ajouter. « Mélancolie ! mélancolie ! axe admirable du désir ! Faiblesse du rêve à qui aucun secours, hors le baiser, n'est assez proche, pleur de l'homme devant la nature, éternel repliement d'Ève et d'Adam ! Ceci fixe la qualité des lectures prépondérantes.
Le sens de l'antique est plus pur que chez Renée Vivien ; on ne trouve chez la comtesse de Noailles aucune réminiscence, même confuse, de l'Océan barbare, ni des troubles particuliers à la conscience chrétienne. La demi-grecque oublie la notion du péché. Elle songe la Mort comme l'ont songée les plus anciens d'entre les Anciens. C'est un obscur endroit d'où l'on pense à la vie avec quelque regret et d'où l'on veut savoir les nouvelles de notre monde. Les morts sont consolés, quand un trou creusé dans la terre insinue jusqu'au séjour où l'ombre se mêle à la cendre un rayon de miel, un filet de lait et de vin. Le poète raffiné du Cœur innombrable charge un faune de ses commissions pour le Styx, mais la collation rituelle est augmentée d’un mets nouveau : c'est le don royal d'elle-même, et ce présent fait a des Ombres, qui n'en peuvent goûter - elle le dit - pourra paraître assez méchant :
Dis-leur comme ils sont doux à voir,
Mes cheveux bleus comme des prunes,
Mes pieds pareils à des miroirs
Et mes deux yeux couleur de lune.
Et dis-leur que, dans les soirs lourds,
Couchée au bord des fontaines,
J’eus le désir de leurs amours,
Et j’ai pressé leurs ombres vaines.
Cette offrande fera voir en quel sens baudelairien la comtesse de Noailles transforme l'antique. On le sentira mieux en lisant un autre poème, moins réussi, l'historiette de la petite Bittô. Bittô bergère vient de se donner, en une vingtaine de strophes, à son berger Criton. Quand elle est bien vaincue, le poète pousse une exclamation : « Comme elle est grave et pâle! » et continue : « Bittô, je voire dirai votre grande méprise »
Le commentaire des méprises de Bittô dure six bonnes strophes, où la vagabonde pensée noue et dénoue, sans rien indiquer de bien net, de molles écharpes. L'objet s'est évanoui dans le rêve, le sujet dans la paraphrase et l'églogue dans un lyrisme intempestif. Voici l'équilibre rompu entre les figures vivantes et le mouvement dont on veut qu'elles soient animées : ces figures paraissent, dès lors, tout agitées et consumées du feu intérieur, en une heure où l'âme devrait se reposer, languir. Les Anciens n'auraient jamais péché ainsi contre l'ordre. Sans l'ordre qui donne figure, un livre, un poème, une strophe n'ont rien que des semences et des éléments de beauté.
Le second recueil de Madame de Noailles, « L'ombre des jours » précise la valeur de ces éléments précieux. Il achève de révéler quel trésor de puissance poétique accumulent certaines natures frémissantes. La sensibilité diffère de l'art ; mais elle est la matière première de l'art. Un certain degré de sensibilité, également distribuée et répartie, peut suppléer à la raison et tenir la place du goût. Or, l'excès fait la loi ici. Bien plus, de cette belle et forte sensibilité naturelle, une volonté résolue abuse méthodiquement. La jeune femme ne se complaît qu'à sentir, à se voir sentante et souffrante. Sa frénésie de sentiment, toujours consciente et voulue, la dévoile, l'écorche même, afin de la faire apparaître plus nue. Le poète se soucie donc de moins en moins de forger des représentations cohérentes, des images suivies, mais dans la négligence se font les rencontres heureuses :
J’entendrai s’apprêter dans les jardins du temps,
Les flèches de soleil, de désir, d’envie
Dont l'été blessera mon cœur tendre et flottant.
Le poète abandonne semblablement les descriptions, auxquelles il s'appliquait jadis avec une méritoire constance, et ces héros obscurs du jardin potager, haricots, radis, fleurs de pois, auxquels était dévoué le premier volume, sont relégués en un second plan à peine sensible. Ce que l'auteur demande désormais aux arbres, aux buissons, à la nature entière, c'est d'exciter ses nerfs, d'extasier son rêve, de lui apporter l'occasion du mouvement passionné. A ce titre, les vraies fleurs, ces fleurs du vieux temps qui charmèrent tous les poètes, refleurissent dans le jardin qui leur avait préféré des légumineuses. En l'absence des roses, jugées sans doute un peu trop simples, voici déjà brûler dans l'air amoureux de la nuit « l'héliotrope mauve aux senteurs de vanille ». A la description se substitue donc une émotion, mais élancée, autant que faire se peut, des régions les plus végétatives et les plus nocturnes de l'âme :
Mon âme si proche du corps !
Mon âme d'ombre et de tourment
Et celle qui veut âprement
Le sang de la tendresse humaine !
O mes âmes désordonnées !
Ces petites âmes diverses, avides, brutales, - un physiologiste dirait - ces petits centres nerveux de systèmes inférieurs, - ces âmes d'impression plus que de réflexion et d'organisation, ces petites volontés toutes sensuelles, sont expressément chargées de tout passionner. Un train qui part, « beau train violent » st invoqué comme le « maître de l'ardente et sourde frénésie ». Dans le thème d’amour, le détail de physiologie alterne avec le cri :
Ah ! tant de plaisir et de larmes !
Tu ne dors, ne ris, ni ne manges,
Mais n’importe, c’est le bonheur !
Un tel état de tension morale ne peut manquer de laisser jaillir, en aigrettes ou en étincelles, de purs et de nobles agencements de syllabes, tels que le début de la deuxième strophe, dans le Dialogue marin, où la double épithète accordée à la mer pourrait être du plus magnifique poète :
Visage étincelant du monde, battement
Du temps et de la vie !
Il va sans dire : ce ne sont, ce ne peuvent être que des fragments. Nulle composition réelle, quoique l’auteur sente toujours où il va et, de biais ou de droit, qu’il puisse toujours aller. Ni providence, ni pensée. Les éléments se groupent selon leu poids ou leur venue. Ne lui demandez pas de soigner autre chose que ses clameurs.
La « Nouvelle espérance », véritable roman poème, animé d’une rare passion est conçue n’importe comment et le train du récit marche comme il peut. Une jeune dame qui s’ennuie essaie d’aimer son mari et successivement tous les amis de son mari. Elle trouve enfin, un peu en dehors de son entourage ordinaire, quelqu’un à qui se donner. Mais cet amant aimé n’est cependant pas le bonheur, pour deux raisons majeures : il n’y a pas de bonheur pour Sabine et, de plus, cet amant ne peut être toujours à sa disposition. Certain soir, dont le lendemain semble vraiment trop long à vivre sans lui, Sabine s’arrête à la pensée de mourir. Cette fin qu’on traite d’absurde paraît la seule raisonnable si l’on comprend la donnée première. Encore la mort même n'est peut-être pas assez calme, assez froide, assez morte pour éteindre éternellement ce forcené démon d'amour qu'il s'agit de tuer. Tout le démoniaque, dans ce livre, est parfait. Quand il s'agit de peindre des personnages que le démon d'aimer n'agite pas, qui sont « lâches devant l'amour », ou quand il faut imaginer des anecdotes, des aventures, des circonstances, le livre tombe. Non faiblesse. Non parti pris. On dirait plutôt ironie et négligence - Pourquoi machiner, composer ! Un seul point a de l'intérêt : ce qui se passe dans une âme quand elle aime ou qu'elle erre dans les environs de l’amour, la rencontre de ceux qui s'aiment, leurs conversations, ces étreintes, ces « caresses immatérielles des âmes ». Un artiste plus docte aurait effacé tout ce qui n'est pas cela. Celui-ci s'est contenté de le gribouiller. Mais il s'est enfoncé de toutes ses forces dans l'analyse du désir de la passion et dans la formule, aussi réelle. que possible, de cette passion enfin trouvée et sentie.
De grands poètes qui exposent les infortunes des amants veulent nous émouvoir de pitié ou d'horreur. Celui-ci n'a aucune arrière-pensée théâtrale. Il n'a point d'autre but que de dire l'amour ou plutôt de le confesser. Il nous confesse son amour. Je voudrais oser dire qu'il l'extériorise. Comme le jeune auteur d'Occident tendait à trouver, des paroles qui pussent la dire, vivante, vraie, dans les caractères particuliers de son imagination, le jeune auteur de La Nouvelle -Espérance cherche à faire voir avec vérité ce que c'est que son cœur de femme, conçu, non au repos, où il n'est point lui-même, mais au plus vif, au plus rapide, au plus effréné des mouvements qui mettent le fond bien à nu ; non dans le rêve et dans l’attente, mais à la fleur des heures où brûle le plus haut sa plus chaude flamme d'amour. Je suis loin de nier l'éminente curiosité du spectacle. Cependant, ces efforts de description intérieure participent de la science plus que de l'art. Il me semble que le succès en sera toujours relatif.
Si, d'un tableau à un autre, il n'existe jamais de copie parfaite, comment serait-on jamais satisfait de la version de nos états intérieurs dans le langage extérieur, de notre vie propre dans un monde qui est commun et qui doit l'être ? Quelque concret et sensuel que soit un style, les mots sont toujours une algèbre, leurs symboles ne feront jamais la réalité : ils ne la refléteront même pas.
Aussi n'est-on jamais satisfait, même de l'outrance, et faut-il toujours la porter plus avant. Par essais graduels, par entraînement méthodique, les phénomènes insensibles ou à peine perçus jusque-là prennent une forme distincte. L'hyperesthésie maladive s'accentue volontairement et s'accompagne de perversions bizarres. La couleur des mots apparaît et, leur arôme s'annonce. En même temps qu'il se colore et se parfume, l'univers intellectuel commence à revêtir un accent plus aigu, dont le patient commence à souffrir. Ce qui chatouillait blesse, ce qui blessait déchire. Cette tension nerveuse, développée, accrue par la volonté complaisante, devient un jour insupportable; comme le gentil- homme dont M. Huysmans a dressé la monographie, on commence à se trouver assez mal portante ; comme Sabine de Fontenay, on court chez le docteur :
- Docteur, cela va très mal.
Il lui répondit :
- D'abord asseyez-vous tranquillement. Mais elle reprit -
- Je n'ai pas la force de m'asseoir tranquillement, on ne se repose que quand on est bien portant. Elle ajouta : Il faut que vous me guérissiez tout de suite, je vous en supplie, de cette douleur que j'ai dans la nuque tout le temps, et d'une tristesse qui me met des larmes dans toutes les veines.
Il lui conseilla le calme, le sommeil, la nourriture. Il la pria de regarder doucement la vie, indifférente et drôle. Il l’assura des plaisirs prudents qui attendent l’observateur et l’amoureux de la nature. Elle lui dit :
- Alors, docteur, le soleil et les soirs violets, et des bouts de nuit ou semblent s’égoutter encore les lunes qui furent sur Agrigente et sur Corinthe, ne vous font pas un mal affreux ?
Le docteur répond que la pensée des vieilles lunes lui est, au contraire, bien reposante. Sabine s'en va indignée, en se disant : « La satisfaction seule console. La faim, la soif et le sommeil ne se guérissent point par tel envisagement de l'univers, mais par le pain, l'eau ou le lit, et de même la douleur ne se guérit que par le bonheur ».
Mais l'idée du bonheur elle-même s'est aiguisée. Son amant lui a demandé un jour : "Qu'est-ce qu'il vous faut, à vous, pour que ,vous soyez heureuse ?" Elle tourna vers lui ses yeux d'enfant brûlante, appuya sa tête contre l'épaule de Philippe et répondit : "Votre amour." Puis, jetant dehors sa main nue, faible, puissante, elle ajouta : "Et la possibilité de l'amour de tous les autres !"
Quelque temps après, elle ajoute, dans une lettre, autre chose d'infiniment plus net : « Ce n'est pas vous que j'aime; j'aime aimer comme je vous aime. Je ne compte sur vous pour rien dans la vie, mon bien-aimé. Je n'attends de vous que mon amour pour Vous »
Ainsi un certain degré d'attention sur soi-même en arrive à faire tourner jusqu'à l’amour, comme le mauvais oeil faisait jadis tourner le vin. Oui, l'amour se meurtrit, une fois revenu dans le cœur aimant qui ne l'avait créé que pour se répandre et se fuir. Il se résorbe dans cet élémentaire amour de l'amour que tous les psychologues distingueront de l'amour vrai, dont il est la corruption ou le résidu.
L'amour de l'amour tue l'amour, observait-on plus haut. Ou peut-être n'existe-t-il que pour avoir tué l'amour. Aimer l'amour, c'est s'aimer soi : le livre qui le montre atteint par là un rare caractère de profondeur et de vérité. A force de s'aimer, à force d'accorder à chaque fragment, à chaque minute de soi, l'indulgence absolue et l'adoration infinie, il arrive qu'un de ces fragments, éphémère hypertrophié, devient le meurtrier des autres : il ne peut même plus supporter la pensée des instants à vivre, s'ils ne sont identiques à lui, s'ils sont autre chose que son propre prolongement, et l'être, à ce degré de despotisme, n'aspire plus qu'à s'anéantir : il s'anéantit et se dissout en effet, par amour absolu de soi. « Tu es loin, écrit Sabine à son amant, tu es loin, il faudrait vivre demain sans toi. Je ne peux pas ». Le premier coup de minuit qui sonne aura probablement raison d'elle toute, comme elle a eu raison de tout. Je ne sais pas de suicide romantique mieux motivé ; on y peut voir, toucher, comment une anarchie profonde défait une personne, aussi exactement qu’elle décompose un style ou un art, une pensée ou un État.
-------------
Remarques :
1. bien qu'il soit excessivement long il n'a pas semblé possible de "couper" ce texte qui est donc reproduit dans son intégralité
2. En publiant ce texte, considéré du seul point de vue de l'analyse littéraire, l'auteur ne souscrit pas pour autant aux idées et convictions de Charles Maurras
---------------
L'inquiétude se confirme par la suite du livre; on ne tarde pas à s'apercevoir que, si Racine et Ronsard sont aimés ici, ils n'y sont aucunement préférés. Le suffrage qu'on leur accorde est très partagé. Une petite âme gloutonne s'est contentée de les convier à la posséder, en commun avec une nombreuse société de poètes inférieurs. Les véritables favoris sont bien plus récents et moins purs.
Pour la quatrième fois, nous avons à saluer l'influence persistante et vivace des romantiques sur le plus brillant esprit féminin. C'est bien d'eux que Madame de Noailles a mémoire quand elle songe, écrit et vit. La face épanouie de la lune l'émeut à peu près des mêmes pensées qui auraient visité l'imagination d'une affiliée du Cénacle. C'est la rêverie de Musset devant Pboebé la blonde. A propos d'animaux, des « sobres animaux », quand elle les admire et les salue un à un, en suppliant une divinité champêtre de la rendre elle-même pareille à ces bestiaux suaves : Rendez-nous l'innocence ancestrale des bêtes ! le souvenir de Baudelaire s'entrelace à celui de Vigny, qui voulait que les animaux fussent nos sublimes modèles. Enfin, elle s'est exercée à fusionner, sur les savants exemples de Victor Hugo, le matériel et le mystique, le pittoresque et le rêvé, le sentiment et la chair :
Ah ! le mal que ces deux cœurs, certes,
Se feront ;
Le vent éperdu déconcerte
L’astre rond.
La lune au ciel et sur l'eau tremble,
Rêve et luit ;
Nos deux détresses de ressemblent,
Cette nuit.
Il monte des portes de l’âme
Un encens;
C'est l'appel du cœur, de la flamme
Et du sang.
Nous avons distingué des imitations que l'on fait comme des devoirs ces reprises sincères et fiévreuses, que l'auteur dirait pleines de cœur et pleines de sang. A la fougue, à la vérité, au naturel se reconnaît l'invention. C'est seulement une invention qu'il faut dater et situer. Laissons donc Ronsard et Racine. Voici le centre du poète, voici la date fatidique de son avènement au ciel troublé de la poésie . Dix-huit-cent-trente. S'il était possible d'en douter, nous n'aurions qu'à ouvrir ce roman, la Nouvelle Espérance, qui nous ressuscite à la lettre les sentiments de la génération de René et de celle d'Adolphe, avec cette couleur précise du costume et de la parure que la vogue de 1830 y vint ajouter. « Mélancolie ! mélancolie ! axe admirable du désir ! Faiblesse du rêve à qui aucun secours, hors le baiser, n'est assez proche, pleur de l'homme devant la nature, éternel repliement d'Ève et d'Adam ! Ceci fixe la qualité des lectures prépondérantes.
Le sens de l'antique est plus pur que chez Renée Vivien ; on ne trouve chez la comtesse de Noailles aucune réminiscence, même confuse, de l'Océan barbare, ni des troubles particuliers à la conscience chrétienne. La demi-grecque oublie la notion du péché. Elle songe la Mort comme l'ont songée les plus anciens d'entre les Anciens. C'est un obscur endroit d'où l'on pense à la vie avec quelque regret et d'où l'on veut savoir les nouvelles de notre monde. Les morts sont consolés, quand un trou creusé dans la terre insinue jusqu'au séjour où l'ombre se mêle à la cendre un rayon de miel, un filet de lait et de vin. Le poète raffiné du Cœur innombrable charge un faune de ses commissions pour le Styx, mais la collation rituelle est augmentée d’un mets nouveau : c'est le don royal d'elle-même, et ce présent fait a des Ombres, qui n'en peuvent goûter - elle le dit - pourra paraître assez méchant :
Dis-leur comme ils sont doux à voir,
Mes cheveux bleus comme des prunes,
Mes pieds pareils à des miroirs
Et mes deux yeux couleur de lune.
Et dis-leur que, dans les soirs lourds,
Couchée au bord des fontaines,
J’eus le désir de leurs amours,
Et j’ai pressé leurs ombres vaines.
Cette offrande fera voir en quel sens baudelairien la comtesse de Noailles transforme l'antique. On le sentira mieux en lisant un autre poème, moins réussi, l'historiette de la petite Bittô. Bittô bergère vient de se donner, en une vingtaine de strophes, à son berger Criton. Quand elle est bien vaincue, le poète pousse une exclamation : « Comme elle est grave et pâle! » et continue : « Bittô, je voire dirai votre grande méprise »
Le commentaire des méprises de Bittô dure six bonnes strophes, où la vagabonde pensée noue et dénoue, sans rien indiquer de bien net, de molles écharpes. L'objet s'est évanoui dans le rêve, le sujet dans la paraphrase et l'églogue dans un lyrisme intempestif. Voici l'équilibre rompu entre les figures vivantes et le mouvement dont on veut qu'elles soient animées : ces figures paraissent, dès lors, tout agitées et consumées du feu intérieur, en une heure où l'âme devrait se reposer, languir. Les Anciens n'auraient jamais péché ainsi contre l'ordre. Sans l'ordre qui donne figure, un livre, un poème, une strophe n'ont rien que des semences et des éléments de beauté.
Le second recueil de Madame de Noailles, « L'ombre des jours » précise la valeur de ces éléments précieux. Il achève de révéler quel trésor de puissance poétique accumulent certaines natures frémissantes. La sensibilité diffère de l'art ; mais elle est la matière première de l'art. Un certain degré de sensibilité, également distribuée et répartie, peut suppléer à la raison et tenir la place du goût. Or, l'excès fait la loi ici. Bien plus, de cette belle et forte sensibilité naturelle, une volonté résolue abuse méthodiquement. La jeune femme ne se complaît qu'à sentir, à se voir sentante et souffrante. Sa frénésie de sentiment, toujours consciente et voulue, la dévoile, l'écorche même, afin de la faire apparaître plus nue. Le poète se soucie donc de moins en moins de forger des représentations cohérentes, des images suivies, mais dans la négligence se font les rencontres heureuses :
J’entendrai s’apprêter dans les jardins du temps,
Les flèches de soleil, de désir, d’envie
Dont l'été blessera mon cœur tendre et flottant.
Le poète abandonne semblablement les descriptions, auxquelles il s'appliquait jadis avec une méritoire constance, et ces héros obscurs du jardin potager, haricots, radis, fleurs de pois, auxquels était dévoué le premier volume, sont relégués en un second plan à peine sensible. Ce que l'auteur demande désormais aux arbres, aux buissons, à la nature entière, c'est d'exciter ses nerfs, d'extasier son rêve, de lui apporter l'occasion du mouvement passionné. A ce titre, les vraies fleurs, ces fleurs du vieux temps qui charmèrent tous les poètes, refleurissent dans le jardin qui leur avait préféré des légumineuses. En l'absence des roses, jugées sans doute un peu trop simples, voici déjà brûler dans l'air amoureux de la nuit « l'héliotrope mauve aux senteurs de vanille ». A la description se substitue donc une émotion, mais élancée, autant que faire se peut, des régions les plus végétatives et les plus nocturnes de l'âme :
Mon âme si proche du corps !
Mon âme d'ombre et de tourment
Et celle qui veut âprement
Le sang de la tendresse humaine !
O mes âmes désordonnées !
Ces petites âmes diverses, avides, brutales, - un physiologiste dirait - ces petits centres nerveux de systèmes inférieurs, - ces âmes d'impression plus que de réflexion et d'organisation, ces petites volontés toutes sensuelles, sont expressément chargées de tout passionner. Un train qui part, « beau train violent » st invoqué comme le « maître de l'ardente et sourde frénésie ». Dans le thème d’amour, le détail de physiologie alterne avec le cri :
Ah ! tant de plaisir et de larmes !
Tu ne dors, ne ris, ni ne manges,
Mais n’importe, c’est le bonheur !
Un tel état de tension morale ne peut manquer de laisser jaillir, en aigrettes ou en étincelles, de purs et de nobles agencements de syllabes, tels que le début de la deuxième strophe, dans le Dialogue marin, où la double épithète accordée à la mer pourrait être du plus magnifique poète :
Visage étincelant du monde, battement
Du temps et de la vie !
Il va sans dire : ce ne sont, ce ne peuvent être que des fragments. Nulle composition réelle, quoique l’auteur sente toujours où il va et, de biais ou de droit, qu’il puisse toujours aller. Ni providence, ni pensée. Les éléments se groupent selon leu poids ou leur venue. Ne lui demandez pas de soigner autre chose que ses clameurs.
La « Nouvelle espérance », véritable roman poème, animé d’une rare passion est conçue n’importe comment et le train du récit marche comme il peut. Une jeune dame qui s’ennuie essaie d’aimer son mari et successivement tous les amis de son mari. Elle trouve enfin, un peu en dehors de son entourage ordinaire, quelqu’un à qui se donner. Mais cet amant aimé n’est cependant pas le bonheur, pour deux raisons majeures : il n’y a pas de bonheur pour Sabine et, de plus, cet amant ne peut être toujours à sa disposition. Certain soir, dont le lendemain semble vraiment trop long à vivre sans lui, Sabine s’arrête à la pensée de mourir. Cette fin qu’on traite d’absurde paraît la seule raisonnable si l’on comprend la donnée première. Encore la mort même n'est peut-être pas assez calme, assez froide, assez morte pour éteindre éternellement ce forcené démon d'amour qu'il s'agit de tuer. Tout le démoniaque, dans ce livre, est parfait. Quand il s'agit de peindre des personnages que le démon d'aimer n'agite pas, qui sont « lâches devant l'amour », ou quand il faut imaginer des anecdotes, des aventures, des circonstances, le livre tombe. Non faiblesse. Non parti pris. On dirait plutôt ironie et négligence - Pourquoi machiner, composer ! Un seul point a de l'intérêt : ce qui se passe dans une âme quand elle aime ou qu'elle erre dans les environs de l’amour, la rencontre de ceux qui s'aiment, leurs conversations, ces étreintes, ces « caresses immatérielles des âmes ». Un artiste plus docte aurait effacé tout ce qui n'est pas cela. Celui-ci s'est contenté de le gribouiller. Mais il s'est enfoncé de toutes ses forces dans l'analyse du désir de la passion et dans la formule, aussi réelle. que possible, de cette passion enfin trouvée et sentie.
De grands poètes qui exposent les infortunes des amants veulent nous émouvoir de pitié ou d'horreur. Celui-ci n'a aucune arrière-pensée théâtrale. Il n'a point d'autre but que de dire l'amour ou plutôt de le confesser. Il nous confesse son amour. Je voudrais oser dire qu'il l'extériorise. Comme le jeune auteur d'Occident tendait à trouver, des paroles qui pussent la dire, vivante, vraie, dans les caractères particuliers de son imagination, le jeune auteur de La Nouvelle -Espérance cherche à faire voir avec vérité ce que c'est que son cœur de femme, conçu, non au repos, où il n'est point lui-même, mais au plus vif, au plus rapide, au plus effréné des mouvements qui mettent le fond bien à nu ; non dans le rêve et dans l’attente, mais à la fleur des heures où brûle le plus haut sa plus chaude flamme d'amour. Je suis loin de nier l'éminente curiosité du spectacle. Cependant, ces efforts de description intérieure participent de la science plus que de l'art. Il me semble que le succès en sera toujours relatif.
Si, d'un tableau à un autre, il n'existe jamais de copie parfaite, comment serait-on jamais satisfait de la version de nos états intérieurs dans le langage extérieur, de notre vie propre dans un monde qui est commun et qui doit l'être ? Quelque concret et sensuel que soit un style, les mots sont toujours une algèbre, leurs symboles ne feront jamais la réalité : ils ne la refléteront même pas.
Aussi n'est-on jamais satisfait, même de l'outrance, et faut-il toujours la porter plus avant. Par essais graduels, par entraînement méthodique, les phénomènes insensibles ou à peine perçus jusque-là prennent une forme distincte. L'hyperesthésie maladive s'accentue volontairement et s'accompagne de perversions bizarres. La couleur des mots apparaît et, leur arôme s'annonce. En même temps qu'il se colore et se parfume, l'univers intellectuel commence à revêtir un accent plus aigu, dont le patient commence à souffrir. Ce qui chatouillait blesse, ce qui blessait déchire. Cette tension nerveuse, développée, accrue par la volonté complaisante, devient un jour insupportable; comme le gentil- homme dont M. Huysmans a dressé la monographie, on commence à se trouver assez mal portante ; comme Sabine de Fontenay, on court chez le docteur :
- Docteur, cela va très mal.
Il lui répondit :
- D'abord asseyez-vous tranquillement. Mais elle reprit -
- Je n'ai pas la force de m'asseoir tranquillement, on ne se repose que quand on est bien portant. Elle ajouta : Il faut que vous me guérissiez tout de suite, je vous en supplie, de cette douleur que j'ai dans la nuque tout le temps, et d'une tristesse qui me met des larmes dans toutes les veines.
Il lui conseilla le calme, le sommeil, la nourriture. Il la pria de regarder doucement la vie, indifférente et drôle. Il l’assura des plaisirs prudents qui attendent l’observateur et l’amoureux de la nature. Elle lui dit :
- Alors, docteur, le soleil et les soirs violets, et des bouts de nuit ou semblent s’égoutter encore les lunes qui furent sur Agrigente et sur Corinthe, ne vous font pas un mal affreux ?
Le docteur répond que la pensée des vieilles lunes lui est, au contraire, bien reposante. Sabine s'en va indignée, en se disant : « La satisfaction seule console. La faim, la soif et le sommeil ne se guérissent point par tel envisagement de l'univers, mais par le pain, l'eau ou le lit, et de même la douleur ne se guérit que par le bonheur ».
Mais l'idée du bonheur elle-même s'est aiguisée. Son amant lui a demandé un jour : "Qu'est-ce qu'il vous faut, à vous, pour que ,vous soyez heureuse ?" Elle tourna vers lui ses yeux d'enfant brûlante, appuya sa tête contre l'épaule de Philippe et répondit : "Votre amour." Puis, jetant dehors sa main nue, faible, puissante, elle ajouta : "Et la possibilité de l'amour de tous les autres !"
Quelque temps après, elle ajoute, dans une lettre, autre chose d'infiniment plus net : « Ce n'est pas vous que j'aime; j'aime aimer comme je vous aime. Je ne compte sur vous pour rien dans la vie, mon bien-aimé. Je n'attends de vous que mon amour pour Vous »
Ainsi un certain degré d'attention sur soi-même en arrive à faire tourner jusqu'à l’amour, comme le mauvais oeil faisait jadis tourner le vin. Oui, l'amour se meurtrit, une fois revenu dans le cœur aimant qui ne l'avait créé que pour se répandre et se fuir. Il se résorbe dans cet élémentaire amour de l'amour que tous les psychologues distingueront de l'amour vrai, dont il est la corruption ou le résidu.
L'amour de l'amour tue l'amour, observait-on plus haut. Ou peut-être n'existe-t-il que pour avoir tué l'amour. Aimer l'amour, c'est s'aimer soi : le livre qui le montre atteint par là un rare caractère de profondeur et de vérité. A force de s'aimer, à force d'accorder à chaque fragment, à chaque minute de soi, l'indulgence absolue et l'adoration infinie, il arrive qu'un de ces fragments, éphémère hypertrophié, devient le meurtrier des autres : il ne peut même plus supporter la pensée des instants à vivre, s'ils ne sont identiques à lui, s'ils sont autre chose que son propre prolongement, et l'être, à ce degré de despotisme, n'aspire plus qu'à s'anéantir : il s'anéantit et se dissout en effet, par amour absolu de soi. « Tu es loin, écrit Sabine à son amant, tu es loin, il faudrait vivre demain sans toi. Je ne peux pas ». Le premier coup de minuit qui sonne aura probablement raison d'elle toute, comme elle a eu raison de tout. Je ne sais pas de suicide romantique mieux motivé ; on y peut voir, toucher, comment une anarchie profonde défait une personne, aussi exactement qu’elle décompose un style ou un art, une pensée ou un État.
-------------
Remarques :
1. bien qu'il soit excessivement long il n'a pas semblé possible de "couper" ce texte qui est donc reproduit dans son intégralité
2. En publiant ce texte, considéré du seul point de vue de l'analyse littéraire, l'auteur ne souscrit pas pour autant aux idées et convictions de Charles Maurras
---------------
358. Anna de Noailles : un point de vue contemporain
Séduisante comtesse et poétesse, la belle et vénéneuse Anna de Noailles fut une des reines de Paris au début du siècle. Elle parlait à merveille, enjôlait le monde littéraire et politique de son charme excentrique, rêvait d'honneur et de gloire. Elle eut tous les honneurs, toutes les gloires. Célébrée de son vivant comme une des artistes les plus sensibles, les plus lyriques, les plus flamboyantes de son temps, à peine si les surréalistes osèrent épingler de leurs sarcasmes celle qui fit saigner le cœur de Maurice Barrès. Et bien d'autres... Madame de Noailles (1876-1933) était une sensuelle, une généreuse, une vorace. Grande admiratrice de Victor Hugo, elle tenta comme lui d'embrasser la vie, la nature, le monde de toutes ses ardeurs, de toute sa fièvre. De toute sa mélancolie, aussi : l'égérie d'Edmond Rostand, la protectrice de Cocteau avait secrètement le goût de la cendre et la fascination du tombeau. La grande mondaine était aussi une rebelle : l'aristocrate parisienne, une femme qui n'hésitait pas à s'engager aux côtés de Dreyfus ou des plus pauvres. Il faut réentendre cette voix injustement oubliée, en savourer la force et l'émotion, la vitalité et la morbidité, la sauvagerie et la grâce.
Fabienne PASCAUD,
Télérama, 3 septembre 1997.
357. La correspondance d'Anna de Noailles
Extraits de l'ouvrage consacré à "La correspondance d'Anna de Noailles" par Elisabeth Higonnet-Dugua, sous le titre "Anna de Noailles - Cœur Innombrable", pages 438 à 443.
--------
A partir du mois de février, Anna de Noailles n'eut plus la force d'écrire. Alitée, souffrant sans interruption, luttant contre des hallucinations, ne pouvant presque plus parler, elle dicta ses derniers vers. Hélène de Noailles, Mathieu et Anne-Jules ne quittaient plus son chevet. Le Samedi-Saint, à la veille d'un départ en voyage, l'abbé Mugnier se rendit rue Scheffer. Il fut accueilli par Mathieu qui lui confirma qu'il voyait la comtesse de Noailles pour la dernière fois. Allongée sur son lit dans la chambre aux cretonnes, Anna l'attendait. Il s'assit à son chevet. lui dit combien il avait aimé ses poèmes. Faisant un effort pour parier, elle évoqua ses souffrances. Ils s'entretinrent un court moment. Puis l'Abbé Mugnier lui donna l'absolution. Elle lui baisa la main, il lui demanda la permission de baiser la sienne. Ils restèrent alors un moment silencieux l'un près de l'autre, puis l'abbé Mugnier se retira. Le 11 février 1933, il avait écrit dans son journal après une conversation avec elle, qu'ému de la façon dont Anna avait "prononcé le nom de Dieu", il avait failli lui dire "Je vais vous bénir en son nom".
Il sera assailli de questions sur son dernier entretien avec la comtesse de Noailles. Car on voulut, bien sûr, « tout » savoir. En homme qui avait l'habitude du monde, et en prêtre profondément intègre, il saura rendre ces instants en quelques phrases, sans pour autant trahir jamais l'intimité d'un entretien dont il garda le secret. Avec humour, autant envers la personne qui le questionnait indiscrètement sur les derniers moments d'Anna qu'envers la renommée de la Muse de la rue Scheffer, il répondit par un mot resté célèbre, laissant sur sa faim un interlocuteur avide de curiosité: "Elle m'a dit des choses si belles... Que voulez-vous, j'ai risqué l'absolution !".
Anna de Noailles mourut le dimanche 30 avril 1933, au début de l'après-midi, entourée d'Hélène, Anne-Jules et Mathieu. Elle fut inhumée au cimetière du Père Lachaise près des princes et princesses Bibesco, après un service religieux à la Madeleine. Une foule immense composée de gens connus et inconnus suivit son cercueil. L'abbé Mugnier écrivit qu'aux abords du cimetière "il y avait le peuple qui s'empressait sur le passage du cortège, certains avec de petits bouquets".
Le 1er mai 1933, depuis Mogosoëa où elle venait d'apprendre la mort d'Anna, Marthe Bibesco adressait ces lignes à l'Abbé Mugnier : "Je suis certaine que vous ne mettez pas mes sentiments pour elle en doute. Vous serez peut-être le seul à Paris. Peu m'importe ! Je vous envoie des pétales de roses qui se sont ouvertes dans le jardin de l'ancêtre le prince Martyr, dont, jeune fille, elle a porté le nom. Vous les lui ferez parvenir en les confiant sans doute "à l'Ange des prières qui n'ont pas été entendues".
N'ayant jamais pu la convaincre tout à fait pendant sa vie des sentiments véritables qu'elle m'inspirait, j'ai, du moins, cette consolation de penser que, n'ayant pu lui faire ni bien ni plaisir en ce monde, tandis qu'elle était vivante, il me reste à servir quelque jour sa mémoire en écrivant ce que j'ai su de meilleur sur elle quand elle était dans ses jours généreux et fidèles. Certaines des lettres qu'elle m'a écrites témoignent des éclairs de sympathie qu'elle eut pour moi, quand les "mondains" comme elle disait, acharnés à nous brouiller faisaient trêve, devant la mort, la maladie ou l'apparition d'un livre ! Ainsi, quand vous serez en prières, au bord de ce néant auquel il lui plaisait de croire dans sa jeunesse, dites-lui que je viens de parcourir pour elle les allées de ce jardin où elle a passé un bref moment de son enfance. […] J'ai dit aux vieux ormes, aux noyers, aux peupliers, aux saules, que la fille des Brancovan n'est plus.[…] J'ai souffert de sa longue souffrance, souffert des doutes qui s'élevaient périodiquement dans son esprit en ce qui concernait mes sentiments pour elle, doutes alimentés par ses sycophantes femelles. Quel intérêt avaient-elles à nous diviser pour régner?"
Le même jour, Francis Jammes écrivait :
Un jour tu vins me voir dans ce pays sauvage,
Et je devinai vite alors que c'était toi,
Car tes yeux pleins de nuit ravageaient ton visage
Pâle comme la lune, et versaient leur émoi.
Près des mêmes rosiers qui te tendaient leurs lèvres
S'étend le grand silence où tu me laisses seul.
Ce soir, le rossignol qui brûlait de tes fièvres
Mourra dans cette sphère opaque du tilleul.
Et moi, loin des amis pressés à ton cortège,
Moi jaloux du printemps qu'ils jetteront sur toi,
Je ne pourrai t'offrir que ces flocons de neige
Où passe un chant funèbre entonné par ma voix.
Mais bientôt je prendrai, comme on fait au village
Alors qu'on mène un deuil, lourde comme du plomb,
La croix dont le sommet parfois touche au feuillage,
La croix qui t'étonnait, ô fille d'Apollon
Et je la porterai, troussé dans cette cape
Dont ta bouche fermée a parlé si souvent,
Et que soulèvera l'orage qui s'échappe
D'un coeur qu'ont balayé l'injustice et le vent.
Et je la planterai, ma soeur, ma bien-aimée,
Sur le calvaire étroit dominant Hasparren,
Afin que par-delà les monts et la vallée
Sa douce ombre s'étende et te rejoigne au loin.
Hélène et Constantin Photiadès procédèrent alors au rassemblement et au classement des papiers divers laissés par Anna. Elle qui haïssait le bruit du papier que l'on déchire ne jetait jamais rien, et exigeait que l'on en fît autant, protestant lorsqu'elle entendait le bruit de feuillets froissés. Hélène trouva des documents divers (notes, correspondances, ébauches de poèmes) dans les tiroirs, les boîtes à chaussures, les cartons à chapeaux, et même dans la fameuse soupière de porcelaine qu'Anna avait choisi de placer sur le linteau de la cheminée de sa chambre, en face de son lit. Elle remit à Marthe Francillon-Lobre une enveloppe qui portait son nom. L'enveloppe porte ces mots, de la main de Marthe Francillon-Lobre : "Cette lettre ne m'a été remise qu'après les obsèques de la comtesse de Noailles".
Chère Madame Lobre,
Je meurs dans les plus grandes souffrances humaines que seule soi-même on peut connaître; c'est l'enfer. Je suis seule; aucune main bien-aimée, aucun regard n'aide la pauvre enfant que je suis. J'ai le bonheur de mourir avant vous. Oublions tout ce qui ne fut pas les heures confiantes et éblouissantes de la sainte amitié. Je vous confie tout ce qui reste à faire pour moi. Pensez aux pauvres pastels qui sont rue La Boétie à la fantaisie de la chère Comtesse Greffulhe.
Au nom du cher Barrès, Lorrain, usez pour ce qui est de la publication de mes livres de la femme d'Anne-Jules qui n'a parlé de vous qu'avec respect; pour tout ce qui concerne mes livres, manuscrits, photos, mises en désordre effroyable(s).
Chère Lobre, recueillez en votre cher coeur tout ce qui fut votre enfant suppliciée qui ne croyait pas qu'un tel martyre fût possible. Je n'ai pas tenu tranquillement votre main en mourant, ce qu'avait espéré le cher Barrès. Vous imaginez quelle agonie, quelle mort.
Votre malheureuse amie qui attend pour après tous les soins de votre pieux souvenir. Dites à votre cher mari et à votre nièce parfaite ce que fut ma silencieuse affection. Pensez quelquefois à mon petit collier de Perlette. Anna
[…] "Ne jugez pas, c'est le Jugement Dernier qui compte ; pour le monde, c'est le jugement premier!... Ils condamnent a priori". Cette phrase de l'abbé Mugnier qui pouvait s'appliquer à tant de ses contemporains, convient parfaitement à la comtesse de Noailles, qui fut à la fois adulée et haïe, et à qui la gloire réserva souvent d'amers salaires. Elle aimait la gloire - son idée fixe - rapporte Cocteau qui la connaissait bien, et le disait. Elle le disait même trop, au gré de ses ennemis que ses excès agaçaient.
Excès poétiques parfois ("j'ai mes adjectifs"), excès d'emphase verbale et goût démesuré de la mise en scène. Anna de Noailles aimait qu'on l'écoutât, accaparait la parole, transfigurait le discours en numéro de cirque. "Elle jonglait, arpentait la corde raide, changeait de trapèze, exécutait des tours de cartes". Ses amis dirent aussi qu'elle savait écouter comme personne. Mais il fallait, pour pouvoir le dire, avoir traversé l'écran d'étincelles et les feux d'artifice.
"Madame de Noailles", écrira Colette, "ne livrait que peu d'elle-même, en agitant autour d'elle des paroles nombreuses, comme autant de voiles qu'exigeait sa pudeur. N'aimant pas les questions, elle excellait à y répondre abondamment, avec une vivacité parfaitement évasive".
On lui reprocha aussi de ne s'être pas renouvelée. ("Je n'ai pas su éviter l'insistance... "). La beauté de la poésie d'Anna de Noailles demeure malgré les défauts d'une oeuvre par endroits inégale. Aussi réels qu'ils soient, ses défauts n'ont jamais menacé l'éclat de son talent. Des vers inoubliables, des images étonnantes aux épithètes inattendues se sont échappés de ses mains qui savaient façonner avec une intensité et une aisance égales, l'alexandrin à la pureté racinienne, « l'Impair » que Verlaine avait aimé, ou la prose vivante. L'oeuvre de la comtesse de Noailles est aussi intemporelle que l'espoir, la souffrance et le rêve qui habitent l'âme humaine. A un journaliste qui lui demandait de définir son art, elle répondit: "Je crois que mon oeuvre s'est toujours attachée à refléter la vie".
Anna de Noailles ne connut qu'une seule mesure, qu'elle servit en s'appliquant à ne jamais faillir. Ce fut celle que sa conscience d'écrivain, sa lucidité et son jugement exigeaient d'elle. Elle ne connaissait aucune entrave à l'appréciation de la valeur humaine et du talent où qu'ils se trouvent, pouvant admirer à la fois Jaurès et Barrès, Bernanos et Colette. Ainsi Léon Daudet s'étonnait-il qu'elle puisse à la fois vilipender les opinions politiques qu'il défendait, et louer son talent d'écrivain.
Humaniste absolue, elle ne cessa de croire en l'homme. Revenant inlassablement sur les mêmes interrogations, avec une sincérité et une exigence impitoyables, elle choisit toujours de préférer la souffrance à l'illusion, portant au paroxysme le refus de la demi-mesure et la soif de cette plénitude, de cette joie dont d'Annunzio disait qu'elle était toujours au-delà, "toujours l'autre rive" : "La gioia è sempre l'altra riva".
Dès l'enfance, l'âme d'Anna de Brancovan fut, pour son bonheur et pour sa souffrance, retenue prisonnière des thèmes qui allaient la hanter toute sa vie. Aussi porta-t-elle toujours sur le monde ce même regard vulnérable de la petite fille d'Amphion, qui le soir avant de s'endormir, appuyée à la fenêtre de sa chambre, offrait en silence son visage émerveillé à la nuit et se demandait en contemplant la lune :
"Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été,
Avait, en s'en allant, négligemment jeté
Cette faucille d'or dans le champ des étoiles"
--------
A partir du mois de février, Anna de Noailles n'eut plus la force d'écrire. Alitée, souffrant sans interruption, luttant contre des hallucinations, ne pouvant presque plus parler, elle dicta ses derniers vers. Hélène de Noailles, Mathieu et Anne-Jules ne quittaient plus son chevet. Le Samedi-Saint, à la veille d'un départ en voyage, l'abbé Mugnier se rendit rue Scheffer. Il fut accueilli par Mathieu qui lui confirma qu'il voyait la comtesse de Noailles pour la dernière fois. Allongée sur son lit dans la chambre aux cretonnes, Anna l'attendait. Il s'assit à son chevet. lui dit combien il avait aimé ses poèmes. Faisant un effort pour parier, elle évoqua ses souffrances. Ils s'entretinrent un court moment. Puis l'Abbé Mugnier lui donna l'absolution. Elle lui baisa la main, il lui demanda la permission de baiser la sienne. Ils restèrent alors un moment silencieux l'un près de l'autre, puis l'abbé Mugnier se retira. Le 11 février 1933, il avait écrit dans son journal après une conversation avec elle, qu'ému de la façon dont Anna avait "prononcé le nom de Dieu", il avait failli lui dire "Je vais vous bénir en son nom".
Il sera assailli de questions sur son dernier entretien avec la comtesse de Noailles. Car on voulut, bien sûr, « tout » savoir. En homme qui avait l'habitude du monde, et en prêtre profondément intègre, il saura rendre ces instants en quelques phrases, sans pour autant trahir jamais l'intimité d'un entretien dont il garda le secret. Avec humour, autant envers la personne qui le questionnait indiscrètement sur les derniers moments d'Anna qu'envers la renommée de la Muse de la rue Scheffer, il répondit par un mot resté célèbre, laissant sur sa faim un interlocuteur avide de curiosité: "Elle m'a dit des choses si belles... Que voulez-vous, j'ai risqué l'absolution !".
Anna de Noailles mourut le dimanche 30 avril 1933, au début de l'après-midi, entourée d'Hélène, Anne-Jules et Mathieu. Elle fut inhumée au cimetière du Père Lachaise près des princes et princesses Bibesco, après un service religieux à la Madeleine. Une foule immense composée de gens connus et inconnus suivit son cercueil. L'abbé Mugnier écrivit qu'aux abords du cimetière "il y avait le peuple qui s'empressait sur le passage du cortège, certains avec de petits bouquets".
Le 1er mai 1933, depuis Mogosoëa où elle venait d'apprendre la mort d'Anna, Marthe Bibesco adressait ces lignes à l'Abbé Mugnier : "Je suis certaine que vous ne mettez pas mes sentiments pour elle en doute. Vous serez peut-être le seul à Paris. Peu m'importe ! Je vous envoie des pétales de roses qui se sont ouvertes dans le jardin de l'ancêtre le prince Martyr, dont, jeune fille, elle a porté le nom. Vous les lui ferez parvenir en les confiant sans doute "à l'Ange des prières qui n'ont pas été entendues".
N'ayant jamais pu la convaincre tout à fait pendant sa vie des sentiments véritables qu'elle m'inspirait, j'ai, du moins, cette consolation de penser que, n'ayant pu lui faire ni bien ni plaisir en ce monde, tandis qu'elle était vivante, il me reste à servir quelque jour sa mémoire en écrivant ce que j'ai su de meilleur sur elle quand elle était dans ses jours généreux et fidèles. Certaines des lettres qu'elle m'a écrites témoignent des éclairs de sympathie qu'elle eut pour moi, quand les "mondains" comme elle disait, acharnés à nous brouiller faisaient trêve, devant la mort, la maladie ou l'apparition d'un livre ! Ainsi, quand vous serez en prières, au bord de ce néant auquel il lui plaisait de croire dans sa jeunesse, dites-lui que je viens de parcourir pour elle les allées de ce jardin où elle a passé un bref moment de son enfance. […] J'ai dit aux vieux ormes, aux noyers, aux peupliers, aux saules, que la fille des Brancovan n'est plus.[…] J'ai souffert de sa longue souffrance, souffert des doutes qui s'élevaient périodiquement dans son esprit en ce qui concernait mes sentiments pour elle, doutes alimentés par ses sycophantes femelles. Quel intérêt avaient-elles à nous diviser pour régner?"
Le même jour, Francis Jammes écrivait :
Un jour tu vins me voir dans ce pays sauvage,
Et je devinai vite alors que c'était toi,
Car tes yeux pleins de nuit ravageaient ton visage
Pâle comme la lune, et versaient leur émoi.
Près des mêmes rosiers qui te tendaient leurs lèvres
S'étend le grand silence où tu me laisses seul.
Ce soir, le rossignol qui brûlait de tes fièvres
Mourra dans cette sphère opaque du tilleul.
Et moi, loin des amis pressés à ton cortège,
Moi jaloux du printemps qu'ils jetteront sur toi,
Je ne pourrai t'offrir que ces flocons de neige
Où passe un chant funèbre entonné par ma voix.
Mais bientôt je prendrai, comme on fait au village
Alors qu'on mène un deuil, lourde comme du plomb,
La croix dont le sommet parfois touche au feuillage,
La croix qui t'étonnait, ô fille d'Apollon
Et je la porterai, troussé dans cette cape
Dont ta bouche fermée a parlé si souvent,
Et que soulèvera l'orage qui s'échappe
D'un coeur qu'ont balayé l'injustice et le vent.
Et je la planterai, ma soeur, ma bien-aimée,
Sur le calvaire étroit dominant Hasparren,
Afin que par-delà les monts et la vallée
Sa douce ombre s'étende et te rejoigne au loin.
Hélène et Constantin Photiadès procédèrent alors au rassemblement et au classement des papiers divers laissés par Anna. Elle qui haïssait le bruit du papier que l'on déchire ne jetait jamais rien, et exigeait que l'on en fît autant, protestant lorsqu'elle entendait le bruit de feuillets froissés. Hélène trouva des documents divers (notes, correspondances, ébauches de poèmes) dans les tiroirs, les boîtes à chaussures, les cartons à chapeaux, et même dans la fameuse soupière de porcelaine qu'Anna avait choisi de placer sur le linteau de la cheminée de sa chambre, en face de son lit. Elle remit à Marthe Francillon-Lobre une enveloppe qui portait son nom. L'enveloppe porte ces mots, de la main de Marthe Francillon-Lobre : "Cette lettre ne m'a été remise qu'après les obsèques de la comtesse de Noailles".
Chère Madame Lobre,
Je meurs dans les plus grandes souffrances humaines que seule soi-même on peut connaître; c'est l'enfer. Je suis seule; aucune main bien-aimée, aucun regard n'aide la pauvre enfant que je suis. J'ai le bonheur de mourir avant vous. Oublions tout ce qui ne fut pas les heures confiantes et éblouissantes de la sainte amitié. Je vous confie tout ce qui reste à faire pour moi. Pensez aux pauvres pastels qui sont rue La Boétie à la fantaisie de la chère Comtesse Greffulhe.
Au nom du cher Barrès, Lorrain, usez pour ce qui est de la publication de mes livres de la femme d'Anne-Jules qui n'a parlé de vous qu'avec respect; pour tout ce qui concerne mes livres, manuscrits, photos, mises en désordre effroyable(s).
Chère Lobre, recueillez en votre cher coeur tout ce qui fut votre enfant suppliciée qui ne croyait pas qu'un tel martyre fût possible. Je n'ai pas tenu tranquillement votre main en mourant, ce qu'avait espéré le cher Barrès. Vous imaginez quelle agonie, quelle mort.
Votre malheureuse amie qui attend pour après tous les soins de votre pieux souvenir. Dites à votre cher mari et à votre nièce parfaite ce que fut ma silencieuse affection. Pensez quelquefois à mon petit collier de Perlette. Anna
[…] "Ne jugez pas, c'est le Jugement Dernier qui compte ; pour le monde, c'est le jugement premier!... Ils condamnent a priori". Cette phrase de l'abbé Mugnier qui pouvait s'appliquer à tant de ses contemporains, convient parfaitement à la comtesse de Noailles, qui fut à la fois adulée et haïe, et à qui la gloire réserva souvent d'amers salaires. Elle aimait la gloire - son idée fixe - rapporte Cocteau qui la connaissait bien, et le disait. Elle le disait même trop, au gré de ses ennemis que ses excès agaçaient.
Excès poétiques parfois ("j'ai mes adjectifs"), excès d'emphase verbale et goût démesuré de la mise en scène. Anna de Noailles aimait qu'on l'écoutât, accaparait la parole, transfigurait le discours en numéro de cirque. "Elle jonglait, arpentait la corde raide, changeait de trapèze, exécutait des tours de cartes". Ses amis dirent aussi qu'elle savait écouter comme personne. Mais il fallait, pour pouvoir le dire, avoir traversé l'écran d'étincelles et les feux d'artifice.
"Madame de Noailles", écrira Colette, "ne livrait que peu d'elle-même, en agitant autour d'elle des paroles nombreuses, comme autant de voiles qu'exigeait sa pudeur. N'aimant pas les questions, elle excellait à y répondre abondamment, avec une vivacité parfaitement évasive".
On lui reprocha aussi de ne s'être pas renouvelée. ("Je n'ai pas su éviter l'insistance... "). La beauté de la poésie d'Anna de Noailles demeure malgré les défauts d'une oeuvre par endroits inégale. Aussi réels qu'ils soient, ses défauts n'ont jamais menacé l'éclat de son talent. Des vers inoubliables, des images étonnantes aux épithètes inattendues se sont échappés de ses mains qui savaient façonner avec une intensité et une aisance égales, l'alexandrin à la pureté racinienne, « l'Impair » que Verlaine avait aimé, ou la prose vivante. L'oeuvre de la comtesse de Noailles est aussi intemporelle que l'espoir, la souffrance et le rêve qui habitent l'âme humaine. A un journaliste qui lui demandait de définir son art, elle répondit: "Je crois que mon oeuvre s'est toujours attachée à refléter la vie".
Anna de Noailles ne connut qu'une seule mesure, qu'elle servit en s'appliquant à ne jamais faillir. Ce fut celle que sa conscience d'écrivain, sa lucidité et son jugement exigeaient d'elle. Elle ne connaissait aucune entrave à l'appréciation de la valeur humaine et du talent où qu'ils se trouvent, pouvant admirer à la fois Jaurès et Barrès, Bernanos et Colette. Ainsi Léon Daudet s'étonnait-il qu'elle puisse à la fois vilipender les opinions politiques qu'il défendait, et louer son talent d'écrivain.
Humaniste absolue, elle ne cessa de croire en l'homme. Revenant inlassablement sur les mêmes interrogations, avec une sincérité et une exigence impitoyables, elle choisit toujours de préférer la souffrance à l'illusion, portant au paroxysme le refus de la demi-mesure et la soif de cette plénitude, de cette joie dont d'Annunzio disait qu'elle était toujours au-delà, "toujours l'autre rive" : "La gioia è sempre l'altra riva".
Dès l'enfance, l'âme d'Anna de Brancovan fut, pour son bonheur et pour sa souffrance, retenue prisonnière des thèmes qui allaient la hanter toute sa vie. Aussi porta-t-elle toujours sur le monde ce même regard vulnérable de la petite fille d'Amphion, qui le soir avant de s'endormir, appuyée à la fenêtre de sa chambre, offrait en silence son visage émerveillé à la nuit et se demandait en contemplant la lune :
"Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été,
Avait, en s'en allant, négligemment jeté
Cette faucille d'or dans le champ des étoiles"
356. Edouard Herriot : hommage à Anna de Noailles
HOMMAGE A ANNA DE NOAILLES
par le Président Edouard Herriot, de l'Académie Française.
in revue « Les Dialogues ». Numéro de janvier 1952
Elle fut, elle-même, un éblouissement suivent le titre qu’elle a donné à l'un de ses recueils. Nul être n'a jamais possédé plus largement le don de l'image, la maîtrise du verbe. On peut lui appliquer les mots de l'auteur latin des Tristes : « tout ce qu’elle tentait d'écrire s'épanouissait en vers colorés comme des fleurs, pleins et savoureux comme des fruits ». Son génie poétique a capté toutes les beautés du monde : la douceur argenté des matins, la splendeur de midi doré par son grand ami le soleil, la tendresse mélancolique des soirs. Mieux que nos plus illustres lyriques, Anne de Noailles sait exalter le moindre détail de la nature : la haie d’églantiers, les baies violettes du prunellier sauvage, le corail d'une épine vinette, un archipel de coquelicots écarlates, l'élan d'un roitelet. Elle a été le chantre du verger, du jardin débordant de germes et de sèves, unie de tout son amour aux créations les plus humbles. Et quand elle avait cessé d'écrire, lorsque, muets d’adoration nous écoutions sa parole se répandre, c'était non pas même de l’éloquence mais une musique, la phrase ingénument raffinée de Mozart ou, plus simplement, la chant éperdu d’un oiseau.
Quelles magies lui avaient fait cette âme unique, ce cœur innombrable ? D’abord par sa mère, si sincèrement artiste des influences lointaines venues de l’Orient. Petite fille elle a vu Byzance, ses minarets bleus, les eaux douces d’Asie, les tombes coiffées de turbans ; elle a respiré ce parfum de musc et de rose qui encense les rives du Bosphore. Elle a compris les paysages de la Grèce qui s’affirment par des lignes, sa terre sans ombre et ses pins verts, ses rares feuillages, d’où s’échappe un fronton de marbre ou la hanche d’une statue. Des liens précieux l’unissent aux humanistes de Crête ; j’ai songé à elle dans les vallées de l’île où de rustiques danseuses marquaient la terre de leurs cadences. Palerme l’accueille dans sa conque d’or. Elle a erré entre les buis des villas romaines. Elle a entendu le cri rauque de l’Espagne et les appels de l’Italie d’une si pressante sensualité.
Mais, pour que son esprit s’apaise, s’il ne se fixe, il lui faut autour de ce Paris qui l’a vue naître, la France, sa patrie décisive, son meilleur amour. Il lui faut le paradis d'Amphion et son allée de platanes, son toit incliné, son lac, sa tourelle enlacée de troènes. Il lui faut la Savoie, ses châtaigniers et ses automnes de cristal. Il lui faut l'Ile de France, le pays de Sylvie. C'est à ces horizons que se culture la rattache ; elle en discerne tous les secrets, la grâce courtoise, l'harmonie mesurée, les nuances. « Mon Ile de France », écrit-elle, et, pour l'y entourer, pour lui faire compagnie, elle évoque auprès d'elle, sans exclusion, tout ce qui fait la gloire de notre pays, de La Fontaine à Rousseau, de l'ancien Régime aux grandes révolutionnaires. Car elle est trop intelligente et trop généreuse pour proscrire :
Je ne choisirai pas dans la splendeur française
Et je veux, mon pays, tout ce que vous vouliez.
Elle a vu passer la robe en pékin bleu de Marie-Antoinette et la maigre silhouette bottée de Bonaparte. Elle aime aussi la France moderne, ce cri de délivrance que fut la Marseillaise, le fier envol du drapeau tricolore et elle ne reniera jamais l’émotion ressentie dans son adolescence à la première lecture du texte qui proclamait l’égalité des hommes dans le droit.
La chère Anna de Noailles demeure pour nous le poète éclatant de la vie, de la vie dans toutes ses richesses, de la vie qui cherche partout un motif d'admirer. Marcel Proust qui a suivi sa carrière avec un enthousiasme passionné, qui voyait dans chacun de ses oeuvres une branche toujours plus haute d’un même arbre, a loué cette universalité de son talent, Rien d'humain ne lui fut étranger. Sa bonté se traduit en pitié pour les faibles, pour les malheureux, et, à l'occasion, pour les coupables. Elle a connu la joie, les larmes, les sanglots, et suivant ses propres termes, « l'honneur de souffrir ». Elle a aimé les héros. Courageuse, elle s'est montrée fidèle aux plus dangereuses amitiés. A tout moment, elle fut hantée par l'effroi de ne plus vivre. En ses derniers jours, elle dicte encore des poèmes. Elle s'est cabrée contre la mort. Je l'en loue pour ma part, la résignation est non pas une vertu mais un vice, une paresse, une lâcheté.
Au sein même de son effroi, elle déclarait écrire pour les jeunes êtres qui lui succéderaient. Je veux croire que ce désir sera exaucé, que son prestigieux exemple éveillera des vocations, pourra révéler à eux-mêmes des talents dans cette France qui a tant besoin de valeurs spirituelles. Pour nous qui avons eu le privilège de l'approcher, […] pour nous qui revoyons la douceur veloutée de son regard sous la frange des cheveux couleur de nuit, nous garderons pieusement tout ce qui nous vient d’elle, ses livres, un peu de son écriture ailée, un pastel de roses azalées, et surtout, sa charmante, son ineffaçable image. oui, nous la garderons au plus profond du cœur.
355. Gabriel Bonnoure : à propos de la Comtesse de Noailles
Le vieil Hugo pensait sur les femmes à peu près comme Thalès de Milet :
Thalès n'était pas loin de croire que le vent
Et l'onde avaient créé les femmes...
Madame de Noailles vérifie cette hypothèse sur la syncrasie féminine. Sa poésie appartient à la nature liquide et aérienne. Qu'on ne cherche pas en ses livres la terre rouge de la Genèse, ni le magnétisme tellurique, ni le Feu artiste qui sculpte la forme et produit l'essence. Elle n'a même pas l'idée de cette recherche savante ou de cette ivresse magique qui font d'un Rimbaud ou d'un Baudelaire les égaux de Dante et de Milton. Sa fougue même n'est pas celle de la passion, c'est une fureur d'abondance et de coquetterie.
Le mouvement de ses odes rappelle les vains bondissements de l'onde avec le poudroiement des gouttelettes dans le soleil : Iris dans la cascade et sous la pomme de l'arrosoir. Les lois de l'équilibre des fluides expliquent ces déferlements et ces bonaces pâmées, ces volutes brillantes « toujours recommencées », cette abondance, cette mollesse, ces échecs de la strophe qui jamais ne découragent la strophe suivante, comme la vague n'est jamais lasse d'avoir vu la vague précédente mourir sur le récif. Des adjectifs inanes se balancent comme l’écume amassée par le flot et que disperse l’aquilon. Suprême réussite de ce «style coulant» haî par Baudelaire
Je sais que l'air est lent pendant ce mois d'azur
Et tout tremblant d'abeilles noires
Et que l'univers est, si liquide, si pur !
Une belle eau qu'on voudrait boire.
Négligeons le second vers versé là uniquement pour remplir la strophe jusqu'au bord. Les trois autres ouvrent la voie osmotique qui permet à l'onde de rejoindre l'onde et mêlent aux eaux amères du vieil univers l'eau parfumée de cette inspiration. Car l'eau qu'épanche la coupe de ses hymnes éclatants est toujours parfumée, par grâce coquette, par caprice feint, par tour d'enfant gâté. Pourquoi ne dirais-je pas que les abeilles sont noires puisque je suis irrésistible ?
Si le devenir impitoyable a pour effet de faner avec rapidité la musique et l'esprit même des plus brillantes époques au point que la génération postérieure ne voit que niaiserie dans ce qui causa l'ivresse et le rire de ses aînés, un semblable destin échoit à toute poésie qui n'est pas immortellement préservée contre le temps par une grande force de conception et d'expression. Nombreux sont les poèmes de Mme de Noailles qui révèlent aujourd'hui comme un bain chimique la sottise de la sensibilité d'avant-guerre, celle des admirateurs d'Henri Bataille, celle, il faut bien le dire, de quantité de lettres de Marcel Proust, le peintre des Guermantes ayant commencé par être l'un de ses propres héros.
Ah ! si, tiède d'azur, la terre occidentale
Est paisible en été,
Les langoureux trésors que l'Orient étale
Brûlent de volupté.
Tolède, Stamboul et les nigauds du « grand tourisme » littéraire. Si je considère ce sentiment de la Grèce et de l'Orient auquel Madame de Noailles a demandé tant de parfums, de baumes et d'éblouissements, j'y cherche en vain cette grâce dont un Chénier a su parer sa délicate Hellade. Je n’y trouve que banalité, fadeur et vulgarité roturière. Trop de vers langoureusement ourlés le long d'un Bosphore d'aquarelle, trop de rahat-loukoums vendus dans le passage des Panoramas. Notre société, hélas ! n'est plus une de ces sociétés comme on en a vu à telle époque privilégiée où l'air du temps, une certaine beauté générale pouvaient donner aux « poetae minores » l'occasion d'accéder aux honneurs de la Muse, où le commun était encore assez rare pour défrayer la poésie. Faute d'avoir su distinguer la poésie et la mode, l'auteur du « Coeur Innombrable » a versé dans un romanesque d'affiches de gare propre à flatter la précieuse sensibilité des passagers de première classe des Messageries Maritimes.
Madame de Noailles ne sera jamais du nombre des nobles dames ayant l'intelligence d'amour. Elle n'a aucune espèce d'imagination. Ce défaut lui interdit les grandes inventions de la spiritualité, la bannit du monde idéal et surnaturel. Sa poésie est toute adhérente au fait : elle chante les ébranlements d'une sensibilité serve de la nature. C'est au ras du sol et couchée sur la Terre, gardienne des morts, qu’elle a jeté quelques beaux cris et trouvé de déchirants accents.
A bien voir, que ferait ici l'imagination, sinon d'émousser le choc de l'irrévocable événement, de pallier le visage de la fatalité et par là d'affaiblir la source de cette éloquence insistante, acharnée, anxieuse :
Entends-moi, je reviens d'en haut, je te le dis,
Dans l'azur somptueux toute âme est solitaire
Mais la chaleur humaine est un sûr paradis ;
Il n'est rien que les sens de l'homme et que la terre.
Poésie de la sensation immédiate, où rien ne concerne l'homme idéal, où tout exprime la femme vêtue de sa seule chevelure, sans défense, sans recours contre l'univers inexorable. Madame de Noailles a donc, en dépit de ses coquetteries despotiques et de ses fatuités ridicules, un mystère pathétique qu'elle atteste presque sans s'en douter. Ses premiers recueils expriment l'affinité occulte, mais apparente en Orient, de la femme et des jardins, de la femme et des végétaux. Dans les vers désespérés de ses derniers livres luisants et noirs comme le cœur de l'anémone, elle renouvelle la prodigieuse faculté de répétition, les redoublements infinis des pleureuses d'Adonis.
Par là, cette poésie, événement parisien, finit par se découper en silhouette, sur le fond d'augustes origines. Et il n'est pas rare que çà et là, entre le flux et le reflux de ces développements et dans le flot de cette fatale éloquence, un vers se balance avec une séduisante mollesse, mélodieux comme le bonheur nu de vivre, plume d'alcyon sur l'eau bleue d'une baie sicilienne. Mai 1931
----------------------
Jean Henri Gabriel Bounoure, né le 12 mai 1886 à Issoire dans le Puy-de-Dôme et mort le 23 avril 1969 à Lesconil, est un écrivain français et un critique de poésie. Salah Stétié l'a défini étant comme « l'un de ces esprits extraordinairement déliés, l'une de ces sensibilités à vif, faites de limpidité et de réserve obscure, à qui beaucoup doivent leur approche fascinée du poème. »(Source Wikipédia)
----------------------
354. Florilège et citations
"Seul le plaisir physique contente l'âme pleinement"
"Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour"
"Et la volupté n'est, peut-être, je le crois, Que l'essai de mourir ensemble"
"Le corps, unique lieu de rêve et de raison, Asile du désir, de l'image et des sons"
"Solitude : la double solitude où sont tous les amants"
"Si quelque être te plaît, ne lutte pas, aborde ce visage nouveau sur lequel est venu se poser le soleil de tes yeux ingénus"
"Seul le plaisir physique contente l'âme pleinement"
"Qu'importent tes défauts ? Je t'aime comme si tu n'existais pas"
"Je crois à l'âme, si c'est elle qui me donne cette vigueur de me rapprocher de ton coeur quand tu parais sombre et rebelle !"
"Quand ce soir tu t'endormiras loin de moi, pour ta triste nuit, en songe pose sur mon bras ton beau col alourdi d'ennui"
"Tes doux jeux, charmants, éphémères, sont faits d'écume et d'âme amère"
"Le courage est ce qui remplace ce que l'on désire"
"Combien de fois aurais-je dû me sentir lasse et sans courage ! Mais mon coeur n'a jamais perdu son désir pour ton beau visage"
"Je cesse d'écouter, d'une oreille attentive, ce frémissant secret qui soulève et ravive"
"Je ne veux pas mourir avant de t'avoir trouvé moins charmant"
"Aucun jour je ne me suis dit que tu pouvais être mortel. Tu ressembles au paradis, à tout ce qu'on croit éternel !"
"J'entends les mots que tu penses et que je n'ai pas écoutés"
"Et la volupté n'est, peut-être, je le crois, que l'essai de mourir ensemble"
"Le corps, unique lieu de rêve et de raison, asile du désir, de l'image et des sons"
"Rêve et secret d'amour : Prolongeant sa douceur étale, le jour ressemble aux autres jours; un craintif et secret amour rêve, sans ouvrir ses pétales"
"Matin, j'ai tout aimé : Atténuez le feu qui trouble ma raison, que ma sagesse seule agisse sur mon coeur, et que je ne sois plus cet éternel vainqueur..."
"Le désir d'oublier : Quand tu me plaisais tant que j'en pouvais mourir, quand je mettais l'ardeur et la paix sous ton toit, quand je riais sans joie..."
"La douleur d'avoir attendu : Mon coeur ne veut te faire aucun reproche des minutes que tu perdais; tu me savais vivante, moi cependant je t'attendais !"
"Le désir triomphal : Le coeur éclaterait comme d'un son du cor s'il entrevoyait... tant de honte pour qu'un corps ne nous prive pas de sa grâce"
"Que fais-tu de ta passion ? : Ne demande rien, mon amour; ne bouge pas, reste en ta place; que ta suave odeur tenace m'ombrage de son net contour"
"Si je n'aimais que toi en toi : Si c'était toi par qui je rêve, toi vraiment seul, toi seulement, j'observerais tranquillement ce clair contour, cette âme brève"
"Aimer, c'est de ne mentir plus : Nulle ruse n'est nécessaire quand le bras chaleureux enserre le corps fuyant qui nous a plu"
"Le coeur heureux l'aidait toujours : Si terrible que soit l'amour, si spontané ferme invincible, le coeur heureux l'aidait toujours... mais tu me seras invisible"
"Ton image où mon âme amoureuse : Non, je ne t'aime pas avec l'honneur sacré, avec l'esprit ravi ! Non, pauvre homme, je t'aime..."
"Le mensonge est un noble secret : Un souvenir dormant cesse d'être coupable s'il consent à garder sa face stable, le mensonge est un noble secret"
"La passion contient l'amour : Ne pouvant pas comprendre ce qu'on aime, on ne fait que doubler son coeur ; on est comme on voudrait que l'on fût..."
"J'entends les mots que tu penses : Je ne puis savoir ce que tu penses, je t'écoute; ta voix peut se mouvoir, je poursuis mon songe et mon doute"
Je ne suis plus ivre de toi ! : Je sais ma force et je raisonne, il me semble que mon amour apporte un radieux secours à ta belle et triste personne"
"Je t'aime : Vis sans efforts et sans débats, garde tes torts, reste toi-même, qu'importent tes défauts ? Je t'aime"
"Sur ton visage aux belles peines : Un soir tu ne parlais pas, tu me regardais à peine, mes yeux erraient à petits pas sur ton visage aux belles peines"
"Je souffre dans mon coeur : J'attends qu'une heure sonne à quelque vague horloge; je souffre dans mon coeur indomptable où se loge..."
"Un désir encore ascendant : Ai-je imprudemment souhaité guérir de toi ? Quelle ignorance m'irritait contre ma souffrance !"
"Mes jours des douleurs sans courage : Je ne t'ai pas connu dans de beaux paysages... qu'en des lieux sans beauté qu'animait ton visage"
"Poème coeur en émoi : J'ai travesti, pour te complaire, ma véhémence et mon émoi en un coeur lent et sans colère"
353. "Vous êtes mort un soir"
Vous êtes mort un soir à l'heure où le jour cesse.
Ce fut soudain. La douce et terrible paresse
En vous envahissant ne vous a pas vaincu.
Rien ne vous a prédit la torpeur et la tombe.
Vous eûtes le sommeil. Moi, je peine et je tombe,
Et la plus morte mort est d'avoir survécu.
352. "Voix intérieure"
Mon ami, quels ennuis vous donnent de l'humeur ?
Le vivre vous chagrine et le mourir vous fâche.
Pourtant, vous n'aurez point au monde d'autre tâche
Que d'être objet qui vit, qui jouit et qui meurt.
Mon âme, aimez la vie, auguste, âpre ou facile,
Aimez tout le labeur et tout l'effort humains,
Que la vérité soit, vivace entre vos mains,
Une lampe toujours par vos soins pleine d'huile.
Aimez l'oiseau, la fleur, l'odeur de la forêt,
Le gai bourdonnement de la cité qui chante,
Le plaisir de n'avoir pas de haine méchante,
Pas de malicieux et ténébreux secret,
Aimez la mort aussi, votre bonne patronne,
Par qui votre désir de toutes choses croît,
Et, comme un beau jardin qui s'éveille du froid,
Remonte dans l'azur, reverdit et fleuronne ;
- L'hospitalière mort aux genoux reposants
Dans la douceur desquels notre néant se pâme,
Et qui vous bercera d'un geste, ma chère âme,
Inconcevablement éternel et plaisant
Le cœur innombrable, poèmes, Calmann-Lévy, 1901
351. Vivre, permanente surprise !
Vivre, permanente surprise !
L'amour de soi, quoi que l'on dise !
L'effort d'être, toujours plus haut,
Le premier parmi les égaux.
La vanité pour le visage,
Pour la main, le sein, le genou,
Tout le tendre humain paysage !
L'orgueil que nous avons de nous,
Secrètement. L'honneur physique,
Cette intérieure musique
Par quoi nous nous guidons, et puis
Le sol creux, les cordes, le puits
où lourdement va disparaître
Le corps ivre d'éternité.
- Et l'injure de cesser d'être,
Pire que n'avoir pas été !
350. Soir d'été
Une tendre langueur s'étire dans l'espace ;
Sens-tu monter vers toi l'odeur de l'herbe lasse ?
Le vent mouillé du soir attriste le jardin ;
L'eau frissonne et s'écaille aux vagues du bassin
Et les choses ont l'air d'être toutes peureuses ;
Une étrange saveur vient des tiges juteuses.
Ta main retient la mienne, et pourtant tu sens bien
Que le mal de mon rêve et la douceur du tien
Nous ont fait brusquement étrangers l'un à l'autre ;
Quel coeur inconscient et faible que le nôtre,
Les feuilles qui jouaient dans les arbres ont froid
Vois-les se replier et trembler, l'ombre croît,
Ces fleurs ont un parfum aigu comme une lame...
Le douloureux passé se lève dans mon âme,
Et des fantômes chers marchent autour de toi.
L'hiver était meilleur, il me semble ; pourquoi
Faut-il que le printemps incessamment renaisse ?
Comme elle sera simple et brève, la jeunesse !...
Tout l'amour que l'on veut ne tient pas dans les mains ;
Il en reste toujours aux closes du chemin.
Viens, rentrons dans le calme obscur des chambres douces ;
Tu vois comme l'été durement nous repousse ;
Là-bas nous trouverons un peu de paix tous deux.
- Mais l'odeur de l'été reste dans tes cheveux
Et la langueur du jour en mon âme persiste :
Où pourrions-nous aller pour nous sentir moins tristes ?
Le cœur innombrable, poèmes, Calmann-Lévy, 1901
349. Paroles à la lune
La lune, dites-nous si c'est votre plaisir,
Ô lune cajoleuse !
Que les hommes se plient au gré de vos désirs
Comme la mer houleuse,
Est-ce votre vouloir que ceux qui tout le jour
Furent doux et tranquilles,
Succombent dans le soir au péché de l'amour
Par les champs et les villes ?
Les baisers montent-ils vers vous comme de l'eau
Qui se volatilise,
Pour faire, à votre front vaniteux, ce halo
Dont sa pâleur s'irise ?
Est-ce pour vous séduire ou vous désennuyer,
Quand vous faites la moue,
Que les hommes s'en vont se pendre ou se noyer,
La lune aux belles joues ?
Brillez-vous pour que ceux qui marchent sans souliers,
Sans joie et sans pécune,
Aient, sur les durs chemins, des rayons à leurs pieds
Pendant vos clairs de lune ?
Dans les coeurs délaissés, dans les coeurs indigents
Qui battent par le monde,
Vous laissez-vous tomber comme un écu d'argent,
Parfois, ô lune ronde ?
Ô lune qui le soir venez boire aux étangs
Et vous coucher dans l'herbe,
Quel mal a pu troubler, d'un désir haletant,
Votre langueur superbe ?
C'est d'avoir vu le bouc irrévérencieux
Et la chèvre amoureuse
S'unir dans la nuit claire, et réveiller les cieux
De leur clameur heureuse ;
C'est d'avoir vu Daphnis s'approcher sans détour
De Chloé favorable...
C'est de sentir monter cette odeur de l'amour,
Ô lune inviolable !
Le cœur innombrable, poèmes, Calmann-Lévy, 1901
348. Les saisons et l'amour
Four seasons
Le gazon soleilleux est plein
De campanules violettes,
Le jour las et brûlé halette
Et pend aux ailes des moulins.
La nature, comme une abeille,
Est lourde de miel et d'odeur,
Le vent se berce dans les fleurs
Et tout l'été luisant sommeille.
- Ô gaieté claire du matin
Où l'âme, simple dans sa course,
Est dansante comme une source
Qu'ombragent des brins de plantain !
De lumineuses araignées
Glissent au long d'un fil vermeil,
Le coeur dévide du soleil
Dans la chaleur d'ombre baignée.
- Ivresse des midis profonds,
Coteaux roux où grimpent des chèvres,
Vertige d'appuyer les lèvres
Au vent qui vient de l'horizon ;
Chaumières debout dans l'espace
Au milieu des seigles ployés,
Ayant des plants de groseilliers
Devant la porte large et basse...
- Soirs lourds où l'air est assoupi,
Où la moisson pleine est penchante,
Où l'âme, chaude et désirante,
Est lasse comme les épis.
Plaisir des aubes de l'automne,
Où, bondissant d'élans naïfs,
Le coeur est comme un buisson vif
Dont toutes les feuilles frissonnent !
Nuits molles de désirs humains,
Corps qui pliez comme des saules,
Mains qui s'attachent aux épaules,
Yeux qui pleurent au creux des mains.
- Ô rêves des saisons heureuses,
Temps où la lune et le soleil
Écument en rayons vermeils
Au bord des âmes amoureuses
Le cœur innombrable, poèmes, Calmann-Lévy, 1901
347. Les paysages - Les rêves
LES PAYSAGES
Les paysages froids sont des chants de Noëls,
Et les jardins de mai de languides romances
Qui chantent doucement les péchés véniels
Et mènent les amants à de douces clémences...
Les paysages froids sont des chants de Noëls.
Les bouquets de palmiers et les fleurs de grenades,
Évaporant dans l'air leurs odorants flacons,
Donnent, au soir venant, d'ardentes sérénades
Qui retiennent longtemps les filles aux balcons...
Les bouquets de palmiers et les fleurs de grenades !
Le charme désolé du paysage roux
Soupire un air connu des vieilles épinettes ;
La grive se déchire aux dards tranchants des houx
Et le corail pâlit aux épines-vinettes...
Le charme désolé du paysage roux !
Le feuillage éperdu des sites romantiques,
Où la lune dans l'eau se coule mollement,
Élance vers le ciel en de vibrants cantiques
Le mensonge éternel de l'amoureux serment...
Le feuillage éperdu des sites romantiques !
Et le rire éclatant des paysages blonds
Court sur l'eau des ruisseaux, dans le maïs des plaines
Et fait tourbillonner les grappes de houblons
Et les abeilles d'or autour des ruches pleines...
Le rire ensoleillé des paysages blonds !
LES REVES
Le visage de ceux qu'on n'aime pas encor
Apparaît quelquefois aux fenêtres des rêves,
Et va s'illuminant sur de pâles décors
Dans un argentement de lune qui se lève.
Il flotte du divin aux grâces de leur corps,
Leur regard est intense et leur bouche attentive ;
Il semble qu'ils aient vu les jardins de la mort
Et que plus rien en eux de réel ne survive.
La furtive douceur de leur avènement
Enjôle nos désirs à leurs vouloirs propices,
Nous pressentons en eux d'impérieux amants
Venus pour nous afin que le sort s'accomplisse ;
Ils ont des gestes lents, doux et silencieux,
Notre vie uniment vers leur attente afflue :
Il semble que les corps s'unissent par les yeux
Et que les âmes sont des pages qu'on a lues.
Le mystère s'exalte aux sourdines des voix,
A l'énigme des yeux, au trouble du sourire,
A la grande pitié qui nous vient quelquefois
De leur regard, qui s'imprécise et se retire...
Ce sont des frôlements dont on ne peut guérir,
Où l'on se sent le coeur trop las pour se défendre,
Où l'âme est triste ainsi qu'au moment de mourir ;
Ce sont des unions lamentables et tendres...
Et ceux-là resteront, quand le rêve aura fui,
Mystérieusement les élus du mensonge,
Ceux à qui nous aurons, dans le secret des nuits,
Offert nos lèvres d'ombre, ouvert nos bras de songe.
Le cœur innombrable, poèmes, Calmann-Lévy, 1901
346. Les parfums
Mon coeur est un palais plein de parfums flottants
Qui s'endorment parfois aux plis de ma mémoire,
Et le brusque réveil de leurs bouquets latents
- Sachets glissés au coin de la profonde armoire -
Soulève le linceul de mes plaisirs défunts
Et délie en pleurant leurs tristes bandelettes...
Puissance exquise, dieux évocateurs, parfums,
Laissez fumer vers moi vos riches cassolettes !
Parfum des fleurs d'avril, senteur des fenaisons,
Odeur du premier feu dans les chambres humides,
Arômes épandus dans les vieilles maisons
Et pâmés au velours des tentures rigides ;
Apaisante saveur qui s'échappe du four,
Parfum qui s'alanguit aux sombres reliures,
Souvenir effacé de notre jeune amour
Qui s'éveille et soupire au goût des chevelures ;
Fumet du vin qui pousse au blasphème brutal,
Douceur du grain d'encens qui fait qu'on s'humilie,
Arome jubilant de l'azur matinal,
Parfums exaspérés de la terre amollie ;
Souffle des mers chargés de varech et de sel,
Tiède enveloppement de la grange bondée,
Torpeur claustrale éparse aux pages du missel,
Acre ferment du sol qui fume après l'ondée ;
Odeur des bois à l'aube et des chauds espaliers,
Enivrante fraîcheur qui coule des lessives,
Baumes vivifiants aux parfums familiers,
Vapeur du thé qui chante en montant aux solives !
- J'ai dans mon coeur un parc où s'égarent mes maux,
Des vases transparents où le lilas se fane,
Un scapulaire où dort le buis des saints rameaux,
Des flacons de poison et d'essence profane.
Des fruits trop tôt cueillis mûrissent lentement
En un coin retiré sur des nattes de paille,
Et l'arome subtil de leur avortement
Se dégage au travers d'une invisible entaille...
- Et mon fixe regard qui veille dans la nuit
Sait un caveau secret que la myrrhe parfume,
Où mon passé plaintif, pâlissant et réduit,
Est un amas de cendre encor chaude qui fume.
- Je vais buvant l'haleine et les fluidités
Des odorants frissons que le vent éparpille,
Et j'ai fait de mon coeur, aux pieds des voluptés,
Un vase d'Orient où brûle une pastille
Le cœur innombrable, poèmes, Calmann-Lévy, 1901
Inscription à :
Commentaires (Atom)